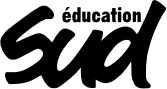Sommaire
- Introduction : Faire de la santé au travail un enjeu collectif !
- Les risques professionnels
- La prévention des risques
- Les possibilités d’alerte : mettre l’employeur face à ses responsabilités
- Le registre de santé et sécurité au travail (RSST*)
- Le signalement de danger grave et imminent (SDGI) et le droit de retrait
- Les acteurs et actrices institutionnel·les
- Les cellules de recueil et de traitement des signalements de violences, discriminations, harcèlement et agissements sexistes (VDHAS*) ou de violences sexistes et sexuelles (VSS*)
- Les assistant·es de prévention et les conseiller·es de prévention
- Les directeur·ices délégué·es à la formation professionnelle et technologique (DDFPT)
- Les inspecteur·ices santé et sécurité au travail (ISST*)
- Les instances
- Les actions possibles quand la santé est affectée, ou quand la sécurité est menacée
- Conclusion : Défendre nos droits et en gagner de nouveaux, la nécessité des luttes collectives
- Glossaire
1 - Introduction : Faire de la santé au travail un enjeu collectif !
Notre employeur est responsable de notre santé et de notre sécurité au travail.
À ce titre, il a une obligation de protection des personnels, de prévention des risques et de résultats. En effet, la jurisprudence a précisé une obligation de résultats et non de moyens dans la protection de la santé des personnels.
Lorsqu’un risque est porté à la connaissance de l’administration, cette dernière est tenue de prendre toutes les mesures à même de supprimer le risque, ou à défaut de mettre en œuvre les mesures de protection adéquates.
Elle doit prendre en compte les risques et adapter le travail à ces derniers, avant même qu’ils surviennent : elle est légalement tenue de mettre en place un plan de prévention des risques et un document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP*) dans l’ensemble des écoles, établissements et services, ce qui n’est quasiment jamais le cas.
Elle doit également former les personnels à tous les risques professionnels : quelles sont les catégories de risques, comment y faire face, comment alerter, quelles sont les personnes ressources, etc.
Les risques professionnels
Il est essentiel de comprendre quels sont les différents types de risque, et notamment comprendre que les risques liés au travail ne sont pas que physiques, mais aussi psychiques.
Nous nous pencherons dans ce guide sur certaines catégories : risques organisationnels dits risques “psycho-sociaux” (RPS*), violences sexistes et sexuelles (VSS*), harcèlement moral, risques physiques : troubles musculo-squelettiques (TMS*), risques liés à l’environnement et au bâti : température, bruit, matériaux dangereux,…
Les grands principes de prévention des risques sont indiqués dans le Code du travail, dont le livre IV s’applique à la Fonction publique (voir chapitre 2).
Les risques professionnels ne sont pas de la responsabilité de l’individu : ils sont liés à l’activité professionnelle et aux situations de travail
Ces risques ne sont pas isolés : ils sont l’aboutissement d’une accumulation de situations problématiques.
Quand les risques surviennent, cela vient de l’organisation du travail qui est défaillante : par le manque de prévention des risques, d’adaptation du travail aux travailleur·euses, de mesures de protection ou d’accompagnement, de moyens, de personnels, de ressources, etc.
Ce n’est donc pas l’individu qui en est responsable, contrairement à ce que dit l’administration qui cherche la plupart du temps à se défausser de sa responsabilité en renvoyant à des responsabilités individuelles. Même les suicides de ses agent·es sont réduits systématiquement par l’Éducation nationale à des « problèmes personnels », ce qui est insupportable.
À SUD éducation, on sait bien que c’est une manière pour l’administration de cacher ses propres défaillances concernant la santé et la sécurité au travail : il y a par exemple plus de vétérinaires dans l’armée française (74 vétérinaires pour un peu plus de 4 000 animaux) que de médecins du travail dans l’Éducation nationale (67 temps pleins en 2022 pour plus d’un million de personnels)… !
Installer une culture du risque
Sans conscience du risque, ce dernier n’est pas pris en compte par les différent·es acteur·ices. Il ne peut donc pas être prévenu, et ses conséquences sont invisibilisées : le risque n’est pas connu et n’existe donc pas.
Face à l’invisibilisation des risques à tous les niveaux de l’administration, c’est le rôle de notre syndicat de rendre visibles les risques professionnels qui sont provoqués par les conditions de travail et qui touchent les travailleur·euses. Pour qu’aucun risque ne soit ignoré, il est nécessaire de mettre en place une véritable culture du risque !
Face aux risques, il faut donc lutter collectivement !
Il faut mettre l’administration face à ses responsabilités en replaçant les situations problématiques dans le cadre organisationnel et collectif. Il y a un fort enjeu à prendre en charge collectivement la question de la santé au travail, question qui ne peut se réduire, comme le voudrait l’institution, à des aspects individuels.
L’action collective nourrit le lien social sur notre lieu de travail, nous permet de continuer à trouver du sens au travail, et elle construit le rapport de force pour contraindre l’employeur à prendre des mesures de prévention, conformément à la loi.
Se syndiquer, (re)construire des collectifs de travail, se sentir légitimes de discuter de l’organisation de notre travail (en réunion ou en heure d’information syndicale par exemple) construire ensemble des revendications… Tout cela permet de se réapproprier nos conditions de travail !
Les outils présentés dans ce guide constituent une première étape pour agir, mais ne peuvent pas se substituer à l’action collective.
La lutte est plus que jamais d’actualité ! Ne perdons plus notre vie à la gagner !
2 - Les risques professionnels
Distinguer risque et danger
Un danger est un produit ou une une situation qui menace la sûreté ou l’existence d’une personne. Un matériau mortel comme l’amiante, un carton rempli placé en équilibre sur une étagère, un comportement inapproprié ou non réglementaire d’un·e collègue sont des dangers.
Un risque est l’éventualité d’un événement qui peut causer un dommage pour la santé ou sur du matériel. Par exemple : dans les services administratifs, l’exposition à des gestes répétés (danger lié à un logiciel de comptabilité) peut causer des troubles musculo-squelettiques (comme une tendinite du bras liée à l’usage de la souris), ou encore dans un établissement l’absence d’isolation thermique expose à des températures extrêmes (fortes chaleurs, températures très basses).
Nous ne listerons pas ici tous les risques de manière exhaustive (vous ne trouverez pas d’information sur les risques électriques, risque d’incendie, risque de chute, risque d’intrusion, etc), mais nous souhaitons attirer l’attention sur un certain nombre de risques professionnels.
Nous avons droit à des locaux de travail adaptés et répondant aux normes de sécurité : chauffage suffisant, salles de taille suffisante, ventilation correcte, nettoyage des ateliers par des personnels formés et non par les élèves, volume sonore… Dans le cas contraire et conformément au Code du Travail, il convient de dénoncer ces situations, par écrit, dans le Registre Santé et Sécurité au Travail (RSST*), auprès des F3SCT*, des Conseils d’École et d’Administration. Rappelons qu’en l’état actuel, plus de la moitié des écoles ne respectent pas le cadre réglementaire ! Nous allons détailler quelques cas sur lesquels nous menons campagne.
L’amiante dans l’éducation en chiffres :
- Selon la base de données du Ministère de l’éducation nationale, environ 90% des écoles et établissements scolaires ont ouvert avant le 1 septembre 1998. Ces bâtiments ont donc été construits avant 1997, date de l’interdiction de l’amiante en France et sont concernés par le risque amiante.
- En 2025, selon le Ministère de l’éducation nationale, seulement 50% des écoles et établissements ont accès au Dossier Technique Amiante (DTA*), document pourtant obligatoire, ou à sa fiche récapitulative, et 40% d’entre eux ne sont pas à jour.
- Selon les DTA réalisés, 80% de lycées professionnels, 77% des lycées généraux et technologiques, 73 % des collèges et 38 % des écoles contiennent toujours de l’amiante.
- Les éléments pour l’enseignement supérieur sont très difficiles à obtenir du fait de la décentralisation : il faut spécifiquement s’adresser à chaque université. Or nous savons que presque toutes les facultés sont concernées par ce risque‧s’adresser spé
L’amiante n’a donc pas disparu des bâtiments et, pire encore, les matériaux et produits contenant de l’amiante (MPCA*) se dégradent avec l’action du temps, ou lorsqu’ils sont soumis à des sollicitations mécaniques (frottements dus au ménage, au passage des personnes avec leurs chaussures, percements, etc.). Et en se dégradant, ces matériaux libèrent dans l’air des fibres d’amiante qui peuvent alors être inhalées, provoquant des maladies graves.
Quand des travaux, mêmes bénins, sont effectués (percer un mur pour installer un vidéo-projecteur par exemple, réfection d’un couloir, etc.), le repérage de l’amiante pourtant obligatoire n’est que rarement effectué, et le risque n’est pas pris en compte.
D’ici à 2050, l’amiante pourrait provoquer 100 000 morts en France selon le HCSP (Haut conseil de la santé publique). Mais combien parmi les personnels de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur et de la recherche ? Entre 1998 et 2017, au moins 20 personnes par an ont contracté un mésothéliome pleural (source : Santé Publique France). Ce chiffre est largement minoré par la sous-déclaration des maladies provoquées par l’amiante, qui de surcroît se déclenchent après des dizaines d’années de latence.
Les pratiques de l’administration : omerta et déni
Les responsables académiques, tout comme le ministère, sont dans le déni et refusent de prendre au sérieux le problème de l’amiante. C’est toute la culture du risque amiante qui est à construire : non, l’amiante n’a pas disparu des bâtiments, il est toujours bien présent, et continue à se dégrader et à libérer dans l’air des fibres hautement cancérogènes .
Que faire ?
SUD éducation a lancé une grande campagne nationale de lutte contre l’amiante en milieu scolaire et universitaire. Toutes les informations sont à retrouver sur notre site :
SUD éducation invite tous les personnels et les usager·ères de l’école à demander les documents obligatoires (Dossier Technique Amiante – DTA*, et Repérage Avant Travaux – RAT*) afin de faire la lumière sur les risques encourus.
SUD éducation invite les personnels à contacter les équipes syndicales locales, à exercer leur droit d’alerte* dès que nécessaire et à exercer leur droit de retrait* si le danger grave et imminent demeure.
Références réglementaires :
- Circulaire fonction publique (dont obligation de signalétique) : Circulaire du 28 juillet 2015 relative aux dispositions applicables en matière de prévention du risque d’exposition à l’amiante dans la fonction publique
- Au sujet du DTA : Articles R 1334 – 17, R 1334 – 18 et R 1334 – 29‑5 du Code de la santé publique
- Obligation d’effectuer un RAT (Repérage avant travaux) : Article R 4412 – 97 du Code du travail
- Obligation de l’employeur de réaliser un plan de prévention : Articles R4512‑6 à R4512-12 du Code du Travail
- Pour l’entretien des dalles vinyle amiante (DVA) :Recommandation CNAM R.514
Le code du travail ne définit pas de seuil de température maximale au-delà duquel un·e salarié·e est autorisé à quitter son lieu de travail. Il est juste indiqué que l’employeur doit « mettre à disposition de l’eau fraîche et potable » et « renouveler l’air pour éviter les élévations exagérées de température ». On peut toutefois s’appuyer sur les données de l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS*) présentées dans le document « Ambiance thermique » : « On estime toutefois qu’au-delà de 30°C pour une activité sédentaire et de 28°C pour un travail physique, la chaleur peut constituer un risque. »
Même si on ne saurait faire valoir qu’au-dessus de 28°C ou en-dessous de 18°C un·e agent·e est autorisé·e à quitter son poste de travail, on peut par contre demander à l’employeur, responsable pénalement de la santé et de la sécurité des personnels, quelles mesures sont mises en place pour prévenir les risques liés à la chaleur ou au froid.
Attention : certaines personnes sont plus vulnérables que d’autres au froid et à la chaleur. Cela fait partie des domaines où l’approche genrée est pertinente. En effet, les normes en termes de confort sont massivement élaborées sur la base du confort pour un homme, qui n’est pas la norme de confort pour tou·tes.
Symptômes pouvant apparaître en cas de forte chaleur : déshydratation, épuisement, coup de chaleur, malaise.
Symptômes pouvant apparaître en cas de froid intense : manque d’attention, parole saccadée, frisson, crispation, chair de poule, engourdissement des extrémités, douleurs, aggravation des maladies respiratoires (asthme, bronchite chronique), affaiblissement du système immunitaire, fatigue.
Recommandations de l’INRS* en cas de forte chaleur ou de froid intense :
- information sur les risques liés à la chaleur ou au froid
- mise à disposition d’aires de repos ombragées
- mise à disposition de sources d’eau potable
- augmentation de la fréquence des pauses
- aménagement des horaires de travail
- évacuation des personnels
- intégration des risques liés aux ambiances thermiques aux Document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP)*
Que faire ?
En cas de températures intolérables, trop froides ou trop chaudes, SUD éducation appelle les personnels à faire respecter leurs droits et ceux des élèves :
- en remplissant les Registres de Santé et Sécurité au Travail (RSST*) obligatoires dans les établissements et écoles ;
- en saisissant par écrit collectivement les Formations spécialisées départementales et académiques (F3SCT*) ;
- en refusant de se mettre en danger lorsque la température est manifestement intolérable, et en faisant collectivement exercice de leur droit de retrait* après avoir mis en sécurité les élèves (dans une salle où l’ambiance thermique est tolérable par exemple).
Références réglementaires :
- sur la température de manière générale : article R4213‑7 du Code du travail
- sur les températures de chauffage : article R4223-13 du Code du travail
- articles R421-26 et R421-27 du Code de l’énergie
- Recommandations de l’INRS* : https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=DO%2029
Depuis la crise de Covid-19, et parce qu’un certain nombre d’écoles et d’établissements ont depuis été dotés de capteurs mesurant la concentration en CO2, la question de la qualité de l’air intérieur est mieux prise en compte.
Cette question ne concerne pas uniquement le CO2 ou les virus mais également les polluants issus des objets, meubles, peintures, etc. comme le formaldéhyde et le benzène qui sont des agents hautement cancérogènes.
Références réglementaires
Un nouveau dispositif de surveillance de la qualité de l’air intérieur (QAI*) dans certains établissements recevant du public a été mis en place et entre en vigueur en 2024.
La réglementation
Le bruit fait partie des causes reconnues de maladies professionnelles depuis 1963. Le principe général de prévention déclare que « l’employeur est tenu de réduire le bruit au niveau le plus bas raisonnablement possible ». Des seuils d’exposition au bruit sont fixés.
La réglementation repose sur trois obligations principales : insonoriser les locaux, agir sur l’environnement de travail (machines notamment), réduire le bruit dans les locaux. La loi considère que des mesures de prévention sont nécessaires dès lors que l’une des situations suivantes est rencontrée sur un lieu de travail :
- ambiance sonore bruyante, comparable à celle d’une rue à grand trafic, d’un restaurant très fréquenté ou encore au bruit d’un aspirateur, pendant la majeure partie de la journée ;
- nécessité d’élever la voix pour tenir une conversation à deux mètres de distance, et ce au moins durant une partie de la journée ;
- utilisation d’outils ou d’équipements motorisés bruyants pendant plus de la moitié de la journée (dans les ateliers de Lycée Professionnel par exemple) ;
- présence de bruits occasionnés par des impacts (lors de travaux notamment).
Les risques sur la santé
Troubles de l’audition
Ils peuvent apparaître selon le niveau sonore et la durée d’exposition. Le seuil de danger au-delà duquel des dommages peuvent survenir est estimé à 85 dB(A) en moyenne sur une journée de huit heures, mais à partir d’un niveau sonore moyen de 80 dB(A) sur huit heures, le niveau d’exposition est préoccupant.
Des paramètres individuels, tels que l’âge, la vulnérabilité personnelle, l’exposition à des médicaments ou produits chimiques toxiques pour l’ouïe, peuvent aggraver les risques.
Si la douleur apparaît vers 120 dB(A), la fatigue auditive survient bien en dessous de ce seuil. Elle se manifeste par une baisse temporaire d’acuité auditive, ou par l’apparition d’acouphènes (sifflements, bourdonnements). Si ces épisodes se répètent, les troubles auditifs peuvent progressivement devenir définitifs : on parle alors de pertes auditives.
Risque accru d’accidents
Le bruit peut couvrir le son émis par un danger imminent ou masquer des signaux d’avertissements.
Risques psycho-sociaux (RPS*)
Le bruit peut affecter la santé au travail : stress, fatigue, troubles cognitifs (fonctions exécutives et mémoire notamment).
Références réglementaires :
Les méthodes managériales qui se mettent en place dans l’Éducation nationale et l’Enseignement supérieur et la recherche (ESR) ont été condamnées par la justice dans d’autres secteurs. Notons, parmi de nombreuses causes pathogènes, le management toxique, l’accueil d’enseignant·es-stagiaires sans formation, l’évaluation des personnels et des établissements permettant leur mise en concurrence, la mise en place d’espaces numériques de travail, véritables outils de contrôle des personnels, l’augmentation des effectifs, l’inclusion sans moyens, les réformes qui se succèdent… L’organisation pathogène du travail est un fait incontestable pour quiconque travaille au sein de l’Éducation nationale.
La définition des RPS* retenue par la Fonction Publique est celle du rapport Gollac-Bodier établi en 2011 à la demande du Ministre du travail, de l’emploi et de la santé : « il convient de considérer que ce qui fait qu’un risque pour la santé au travail est psychosocial, ce n’est pas sa manifestation, mais son origine : les risques psychosociaux seront définis comme les risques pour la santé mentale, physique et sociale, engendrés par les conditions d’emploi et les facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d’interagir avec le fonctionnement mental ».
SUD éducation dénonce l’appellation de “risques psycho-sociaux” qui tend à faire peser sur les individus les causes de risques qui se trouvent dans l’organisation du travail. Mais cette définition rappelle que ce sont bien les dysfonctionnements de l’organisation du travail et ses impacts sur les relations entre personnels (hiérarchiques et/ou horizontales) qui sont à l’origine des risques psycho-sociaux.
6 facteurs d’exposition aux RPS sont caractérisés par le rapport Gollac-Bodier :
- l’intensité du travail et du temps de travail : contraintes de rythme, existence d’objectifs irréalistes ou flous, exigences de polyvalence, responsabilités sans moyens suffisants pour les assumer, éventuelles instructions contradictoires, interruptions intempestives d’activités ou de tâches, …
- les exigences émotionnelles : nécessité de maîtriser et façonner ses propres émotions pour répondre aux exigences du travail. Parmi les facteurs de risques, on retrouve la relation au public (gratifiante mais également pouvant exposer à des risques d’agressions symboliques, verbales, physiques), le contact avec la souffrance, le fait de devoir cacher ses émotions (face à des situations sociales difficiles par exemple)…
- une autonomie insuffisante, ou au contraire, trop grande : choisir ou non sa manière de travailler, pouvoir ou non mobiliser ses compétences à leur juste valeur, être acteur·ice dans son travail, dans sa participation à l’organisation de la tache ou du projet global…
- la qualité des rapports sociaux : les rapports avec les collègues, le niveau d’intégration dans un collectif de travail, les relations avec la hiérarchie, notamment en termes de reconnaissance, la rémunération, les perspectives de carrière, l’adéquation de la tâche à la personne, les procédures d’évaluation du travail…
- les conflits de valeurs : agir en opposition avec ses valeurs professionnelles, sociales ou personnelles. Le conflit de valeurs peut survenir lorsque le but du travail ou ses effets secondaires heurtent les valeurs ou la conscience professionnelle, ou lorsque l’on ressent de la difficulté à pouvoir faire du “bon travail” (qualité empêchée), ou encore quand le travail ne fait pas sens, n’apporte rien (travail inutile)…
- l’insécurité de la situation de travail : la précarité, le risque de perte de son emploi, de voir baisser le revenu qu’on en tire, de ne pas bénéficier d’un déroulement « normal » de sa carrière. C’est également la “soutenabilité” du travail qui est en jeu : est-il possible ou envisageable d’exercer le même travail sur le long terme dans les mêmes conditions ? L’expérience de changements incessants ou incompréhensibles, de fusions, réorganisations, délocalisations impacte aussi bien les personnels qui partent que ceux qui restent…
Les suicides et tentatives de suicide
Dans l’Éducation nationale et l’enseignement supérieur et la recherche, les suicides existent aussi mais très peu sont médiatisés comme celui de Christine Renon. Cet évènement tragique a prouvé, une fois de plus, que les conditions de travail dans l’Éducation nationale sont une source de souffrance, à laquelle non seulement l’administration n’apporte pas de solution mais qu’en plus elle aggrave avec ses réformes pathogènes successives.
Les responsables de l’Éducation nationale, comme des établissements de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, refusent de traiter la question des suicides liés au travail alors que selon le baromètre 2017 de Santé Publique France, l’enseignement est l’un des secteurs d’activité professionnelle les plus touchés et que la France présente l’un des taux de suicide les plus élevé d’Europe.
Questionner l’organisation du travail
Pour SUD éducation, chaque suicide est un drame humain duquel le travail ne peut être évacué. Souvent renvoyé par l’employeur et les médias à des « problèmes personnels », la tentative ou le suicide d’un·e collègue ne peut être déconnecté·e des questions du travail par le fait même qu’il occupe un espace important de nos vies.
Dans l’Éducation nationale et l’Enseignement supérieur, les méthodes de management ont conduit à atomiser les collectifs de travail et isoler les personnels, à réduire leurs marges de manœuvre et à les surcharger de tâches qui ne sont pas au cœur de leur métier.
Nous pouvons donc collectivement émettre l’hypothèse qu’il y a des liens de cause à effet entre les conditions de travail dégradées et le fait qu’une personne envisage de mettre fin à ses jours. Par conséquent, il nous appartient, au sein des collectifs de travail et par l’action syndicale, de rechercher l’existence possible de ces liens. Cette hypothèse et les démarches pour la vérifier sont d’autant plus importantes qu’un suicide peut être révélateur d’une situation d’organisation du travail pathogène et de souffrance au travail globalisée dont l’employeur est l’unique responsable au regard de la Loi (article L4121‑1 du code du travail).
Pour SUD éducation, le management toxique est intrinsèquement lié aux différentes réformes de l’autonomisation des lieux d’enseignement et à l’introduction du “Nouveau management public” dans les services publics. Ce renforcement hiérarchique a des conséquences dévastatrices sur la vie professionnelle des personnels de l’Éducation nationale.
Loin de l’émancipation promise, il impose un néo-management toxique qui s’immisce dans le quotidien. Ce « flicage » permanent est visible à travers des inspections infantilisantes, des demandes de signatures pour chaque réunion, la course effrénée aux publications scientifiques, ou d’autres injonctions qui sont souvent abusives. C’est une taylorisation de l’éducation dans laquelle l’humain est broyé sous le poids d’une hiérarchie obsédée par le contrôle et la productivité dans une logique “d’économie de la connaissance” loin des valeurs d’une école émancipatrice.
Les chef·fes d’établissement, les inspecteur·ices, les services de ressources humaines, sont à la fois les exécutant·es de directives nationales, et des petit·es chefaillon·nes formé·es à des méthodes toxiques.
Dans le premier degré, la loi Rilhac introduit ces méthodes toxiques en attendant des directeur·ices qu’iels se positionnent comme hiérarchie intermédiaire, ce qui contribue à atomiser les collectifs de travail.
Cette pression constante, exacerbée par la mise en concurrence des établissements, accentuée par des classements ubuesques, et l’individualisation des parcours, détruit méthodiquement les collectifs de travail et les solidarités. La logique de performance chiffrée, héritée du privé, vide le métier de son sens et pousse les personnels dans des situations graves. Cela peut se traduire par une souffrance au travail, de l’épuisement, un burn-out voire des suicides.
Face à l’offensive managériale qui nous épuise et nous isole, l’anti-hiérarchie est la solution pour un environnement de travail sain et émancipateur.
Loin d’attendre une protection qui ne viendra pas d’en haut, nous devons nous auto-organiser. Par l’action collective, la grève et la mise en place de structures coopératives autogérées, SUD éducation revendique une gouvernance démocratique et solidaire de l’Éducation Nationale, libérée de la privatisation.
Textes réglementaires
- Protocole d’accord relatif à la prévention des risques psychosociaux dans la fonction publique et circulaire de mise en oeuvre du 20 mai 2014
- Vademecum en matière de prévention des risques psychosociaux dans l’Éducation nationale (ce document n’est pas à jour sur les dernières dispositions concernant les accidents du travail, accidents de trajets, accidents de service et maladie professionnelle. Référez-vous aux chapitres du présent guide)
La loi définit comme harcèlement tout agissement répété (au moins deux fois) ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail qui porte atteinte à la dignité, altère la santé physique ou mentale ou compromet l’avenir professionnel de la personne qui en est victime. Il est puni d’un an de prison ferme et de 15 000 euros d’amende. L’abus d’autorité est une circonstance aggravante du harcèlement. Un·e supérieur hiérarchique qui profite de sa fonction pour vous harceler est donc jugé·e plus sévèrement. Par ailleurs, les méthodes de gestion d’un·e supérieur·e hiérarchique (pression continuelle, reproches incessants, ordres et contre-ordres dans l’intention de diviser l’équipe, mise à l’écart intentionnelle, etc.) peuvent être qualifiées de harcèlement moral.
En cas de harcèlement mettant en cause le-la supérieur·e hiérarchique, l’obligation de passer par voie hiérarchique pour faire remonter la situation est suspendue. Vous pouvez donc vous adresser directement au·à la supérieur·e de votre supérieur·e. Dans les faits, il ne faut pas se faire d’illusions quant à d’hypothétiques sanctions contre le·la harceleur·euse. La hiérarchie protège très souvent les chef·fes, qu’elle peut à l’occasion muter. Par ailleurs, le ou la supérieur·e hiérarchique a obligation de protéger du harcèlement le personnel qui travaille sous son autorité. En effet, la collectivité publique doit protéger les agent·es de la fonction publique dans l’exercice de leurs fonctions. Vous pouvez donc réclamer l’intervention de votre supérieur·e hiérarchique en cas de harcèlement.
Les violences sexistes et sexuelles ne sont pas des actes isolés, elles contribuent à maintenir un système patriarcal fondé sur la domination et l’exploitation des femmes et des minorités de genre. Les violences sexistes et sexuelles fonctionnent ensemble et on observe un continuum de ces violences : c’est parce qu’il y a un sexisme ordinaire qui est toléré dans notre société que des violences sexistes et sexuelles plus graves sont commises. Toutes les femmes ont été et sont concernées, quel que soit leur âge, leur classe sociale, leur emploi, leur apparence, leur origine, leur lieu de vie…
SUD éducation intervient auprès de l’Éducation nationale et du Ministère de l’Enseignement supérieur pour que l’administration prenne enfin ses responsabilités et sa part dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.
La circulaire du 9 mars 2018 relative à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans la fonction publique définit la politique qui devrait être mise en œuvre par les employeurs publics. Néanmoins, sur le terrain, les équipes de SUD éducation font le constat qu’elle est insuffisamment appliquée et de manière inégale selon les territoires même si l’action syndicale a permis d’obtenir des améliorations significatives dans ce domaine, par exemple avec la mise en place des cellules de lutte contre les VSS au sein des rectorats (voire le paragraphe sur les. cellules de recueil et de traitement des signalements dans la partie 3 du présent guide).
Les violences sexistes et sexuelles sont punies par la loi. Toutefois les textes en vigueur dans la Fonction publique indiquent qu’indépendamment des poursuites pénales, l’administration doit entreprendre certaines actions lorsqu’un cas de violences sexistes et/ou sexuelles est porté à sa connaissance.
Quelques définitions légales :
- Agissement sexiste
Depuis 2015, les agissements sexistes sont interdits dans la loi.
Article L1142‑2 – 1 du code du travail : « Nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. »
- Outrage sexiste
Article 621 – 1 du code pénal : « le fait d’imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. »
- Harcèlement sexuel
Article L1153‑1 du code du travail : « Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. »
L’article 222 – 33 du code pénal précise les peines encourues (emprisonnement et amendes) par les auteurs de harcèlement sexuel qui peuvent être aggravées dans certaines situations. « Se rend coupable du délit de harcèlement sexuel le salarié qui impose à des collègues des propos ou comportements répétés à connotation sexuelle créant un environnement hostile, peu importe qu’il méconnaisse la portée de ses actes. »
- Agression sexuelle
L’agression sexuelle est un délit. Article 222 – 22 du code pénal : « Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. »
Article 222 – 22‑2 du code pénal : « Constitue également une agression sexuelle le fait de contraindre une personne par la violence, la menace ou la surprise à subir une atteinte sexuelle de la part d’un tiers. »
- Viol
Le viol est un crime. Article 222 – 23 du code pénal : « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle. »
Par ailleurs, le sexisme est une circonstance aggravante pour tous les crimes et délits.
Les risques physiques sont très nombreux et beaucoup d’entre eux sont invisibilisés aussi bien dans notre quotidien de travail que dans les prises en charge médicales par la suite. Bien sûr, la situation des professeur·es d’EPS doit être prise en compte, mais aussi celle des enseignant·es d’ateliers en Segpa ou en lycée professionnel. La situation dans les ateliers est souvent problématique et des accidents, parfois très graves, surviennent tous les ans.
Les risques physiques, ce sont également toutes les situations de gestes répétitifs : écriture au tableau, port de charges lourdes, activités répétitives sur un poste informatique (saisie,…), etc.
L’adaptation du travail à l’être humain, qui est inscrite au code du travail (Art. 4121 – 2 du Code du Travail), doit rester la norme. Les moyens humains et techniques doivent être mis en place par l’employeur pour prévenir ces risques.
Les troubles musculo-squelettiques (TMS*)
Définition
Les troubles musculo-squelettiques (TMS) désignent un ensemble de pathologies affectant les tissus mous présents au voisinage des articulations (muscles, tendons, nerfs, vaisseaux, etc.) des membres et du dos. Elles se traduisent par des symptômes douloureux et par une capacité fonctionnelle réduite. Ces affections touchent le poignet, l’épaule, le coude, le rachis ou les membres inférieurs (genoux, pieds).
Les causes multiples des TMS
Des études montrent que les TMS ont des causes variées et cumulatives :
- les contraintes physiques et biomécaniques (efforts musculaires, postures inconfortables, vibrations, températures extrêmes, travail sur écran, …)
- les contraintes organisationnelles (gestes répétitifs, contraintes de temps, …)
- les contraintes psychosociales (notamment demande psychologique, manque de soutien social et de latitude décisionnelle).
TMS et organisation du travail
Le lien entre les TMS et l’organisation du travail est aujourd’hui bien démontré. De plus, on sait que les TMS ne se réduisent pas à la seule dimension biomécanique : les facteurs psychosociaux jouent un rôle important dans l’apparition de ces troubles.
Leur explosion est liée aux transformations apportées aux organisations du travail et aux modes de management, par exemple les démarches de type « Lean»* ou « Kaizen»*. Dans l’industrie comme dans les services, ces méthodes conduisent à des logiques de gestion qui intensifient le travail sans prendre en compte la personne.
C’est ainsi que le stress favorise l’apparition de ces troubles en agissant notamment sur l’activité musculaire, sur la récupération ou sur l’efficacité du geste.
Les affections les plus fréquentes
Parmi les TMS, les affections les plus fréquentes sont celles concernant le poignet (41 % des TMS reconnues en 2012) et la main, du fait du grand nombre de pathologies liées au canal carpien (34 %), à l’épaule (29 %) et au cou. Les TMS liés au rachis, c’est-à-dire la colonne vertébrale (8 %) et aux membres inférieurs (2 %) sont plus rares.
En moyenne, 50 % des TMS reconnus laissent des séquelles permanentes. Les TMS graves sont plus fréquents parmi ceux localisés à l’épaule (80 % entraînent une incapacité) et au rachis (70 %).
Source : étude n°081 de la Dares (Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques du Ministère du Travail), décembre 2016
Le tableau 57 du Code de la Sécurité sociale dresse la liste des TMS permettant une reconnaissance de maladie professionnelle, y compris dans la fonction publique. Cette liste est très limitative, et assortie de conditions très précises, qui doivent être réunies pour ouvrir ces droits. Si toutes les conditions décrites dans le tableau ne sont pas réunies, ou si le trouble concerné ne se trouve pas dans le tableau, alors, ce sont les démarches de reconnaissance de maladie professionnelle dites “hors tableau” qui s’appliquent. Ces démarches sont complexes et nécessitent à minima l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (taux d’IPP*) d’au moins 25%.
Dans tous les cas, contactez votre syndicat SUD éducation local pour être conseillé·e.
SUD éducation rappelle que le croisement et/ou la conjonction de multiples facteurs peut avoir des conséquences dévastatrices et rappelle également que toutes les situations d’arrêts du fait ou en lien avec le travail doivent être considérées comme des accidents du travail ou de service et non comme des arrêts maladie ordinaires (voir chapitre 4).
SUD éducation appelle tous les personnels à signaler chaque situation dangereuse ou à faire des propositions d’amélioration des conditions de travail dans le RSST (voir chapitre 3). L’inscription à ce registre fait foi et permet de déterminer la responsabilité de l’employeur en cas de survenue d’un accident.
SUD éducation rappelle que ces risques doivent être évalués dans les DUERP* et réévalués chaque année (voir chapitre 2).
Pour SUD éducation, l’employeur doit enfin respecter la loi, et notamment les articles L4121‑1 et L4121‑2 du Code du travail.
3 - La prévention des risques
Afin d’éviter les risques, il est nécessaire de mettre en place des mesures de prévention. Cette responsabilité incombe à l’employeur, et est prévue par les textes réglementaires. La prévention se décline en prévention primaire, secondaire et tertiaire. Elle repose sur différents outils : la médecine de prévention, l’évaluation des risques professionnels et les mesures de protection.
Les principes généraux de prévention
Selon le code du travail, c’est à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (article L. 4121 – 1 du code du travail) et selon l’article L4121‑2, de mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121 – 1 du code du travail sur le fondement des neufs principes généraux de prévention suivants :
« 1. Eviter les risques ;
2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3. Combattre les risques à la source ;
4. Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5. Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152 – 1 et L. 1153 – 1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142 – 2‑1* ;
8. Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9. Donner les instructions appropriées aux travailleurs.”
La jurisprudence a précisé la responsabilité de l’employeur dans ce domaine, en substituant à l’obligation de moyen, une obligation de résultat dans la protection de la santé de ses employés (Cass. soc., 28 févr. 2002 ; Cass. soc., 11 avr. 2002)*. Cependant, la cour de cassation dans un arrêt de novembre 2015 dit « Air France », a infléchi l’obligation de résultat de l’employeur au profit d’une d’obligation de « moyens renforcés ». Autrement dit, l’employeur doit prendre tous les moyens pour éviter le dommage. Sa responsabilité est engagée si les moyens ne sont pas jugés suffisants eu égard au risque encouru par l’employé·e.
Donc l’employeur porte la responsabilité pleine et unique de protéger la santé des travailleuse·eurs. Ce n’est pas à ces dernièr·es de s’adapter et de compenser les manques de l’employeur face à ses obligations en matière de santé et sécurité au travail.
Dans la fonction publique, la médecine de prévention joue le rôle que joue la médecine du travail dans le privé. Dans les rectorats et les établissements du supérieur, les services de médecine de prévention sont constitués de médecins du travail, d’infirmièr·es de santé au travail, parfois de psychologues du travail et/ou d’ergonomes.
Les services de médecine de prévention reçoivent les personnels pour des visites médicales, et suivent leur état de santé au regard des expositions aux divers risques matériels, aux polluants chimiques et environnementaux, et aux risques psychosociaux.
Les médecins du travail font également des préconisations d’aménagements de poste, et d’adaptations pour les personnels en situation de handicap. Il faut d’ailleurs savoir que le Conseil d’Etat a jugé que l’employeur engage sa responsabilité, pour faute de service, lorsqu’il ne prend pas en compte les propositions d’aménagement de poste de la médecine de prévention (CE, 12 mai 2022, n° 438121). Elles et ils sont sollicité·es sur les dossiers soumis à l’avis du conseil médical.
Selon le décret 82 – 453 (articles 15 à 28 – 2), elles et ils apportent aussi une expertise médicale sur l’environnement professionnel (accessibilité, hygiène générale des locaux, sécurité, conditions de travail, aménagement organisationnel, équipement matériel, etc…), pour s’assurer que le travail ne nuise pas à la santé des salarié·es et respecte leur intégrité physique et psychologique. Iels peuvent proposer des solutions à l’employeur pour améliorer les conditions de travail (réduction du temps de travail, salles insonorisées, tableaux réglables en hauteur…) de manière générale comme dans les cas particuliers d’adaptation du poste de travail. L’administration est tenue de prendre en compte les observations du ou de la médecin du travail, sinon elle doit s’en expliquer par écrit ou devant la Formation spécialisée en santé sécurité et conditions de travail (F3SCT) compétente.
Par ailleurs, les médecins de prévention sont associé·es à l’analyse des risques professionnels, en particulier des risques psychosociaux ainsi que des causes d’accidents de service ou de travail et de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, contribuent à l’élaboration du programme annuel de prévention, participent aux travaux des formations spécialisées en santé, sécurité des conditions de travail, peuvent participer comme membres expert·es à la commission d’hygiène et de sécurité d’un établissement scolaire, présentent chaque année un rapport d’activité de la médecine de prévention, conduisent des études et des enquêtes épidémiologiques. C’est dire l’importance de leur rôle.
En réalité, les insuffisances du service de la médecine de prévention sont criantes.
Ainsi, selon le rapport annuel 2022 de la médecine de prévention de l’Éducation Nationale, on dénombre à peine 1 médecin à temps plein pour 17 720 agent·es. Pendant longtemps, le ratio préconisé par la Cour des comptes était de 1 médecin pour 2 500 agent·es. Il manquerait donc 84 % des effectifs. Pour que la médecine du travail mène à bien ses missions dans l’Éducation Nationale, il faudrait alors recruter 411 médecins à temps plein. C’est la plus faible couverture en médecine du travail, secteur public et privé confondus. Et les inégalités territoriales sont importantes : seules 26 académies (sur 31) disposaient alors d’un médecin du travail.
Dans ce même rapport d’activité, on peut lire qu’en 2022, 40 188 visites seulement ont été réalisées pour plus de 1 193 500 personnels. Le ministère est loin de pouvoir assurer une visite tous les cinq ans pour chaque personnel, comme c’est pourtant la loi. Pour l’ensemble du ministère de l’Éducation nationale ( le plus gros employeur public), seulement 78 médecins étaient en poste en 2022 pour un équivalent de 67 temps plein. Les 31 infirmier‧es en santé et sécurité au travail et les 29 psychologues du travail qui sont en poste ne pallient pas le manque de médecins. Parmi ces 78 médecins, les deux tiers ont plus de 55 ans et 15 ont plus de 65 ans.
SUD éducation a déjà obtenu la condamnation de plusieurs rectorats au tribunal administratif, comme à Nantes et à Créteil, ce qui a pu mener à l’embauche d’un·e médecin du travail. Cependant la situation reste très critique dans toutes les académies, y compris celles-ci.
La visite médicale d’entrée dans le métier
Jusqu’en 2020, les personnels d’enseignement et d’éducation passaient une visite médicale d’aptitude à la profession au moment de leur entrée dans le métier, effectuée chez un·e médecin généraliste agréé·e et remboursée par l’Éducation nationale. Cette visite a été supprimée par l’ordonnance 2020 – 1447 du 25/11/2020.
La visite d’information et de prévention
Tout au long de sa carrière dans la fonction publique d’Etat, chaque agent·e a droit à des visites médicales d’information et de prévention par le service de médecine de prévention. Ce service, dirigé par un·e médecin du travail, comporte au moins un·e infirmièr·e du travail et parfois des psychologues du travail, éventuellement un·e ergonome. En droit, l’administration est tenue d’organiser une visite d’information et de prévention tous les cinq ans pour tou·tes les agent·es (Art 24 – 1 du décret 82 – 453).
C’est une obligation pour les agent·es si l’administration produit une convocation. Mais il ne peut pas être reproché aux agent·es de ne pas avoir satisfait à cette obligation de visite quinquennale s’iels n’y ont jamais été convoqué·es. Cela relève alors d’une carence de l’État.
La visite médicale à la demande
Par ailleurs, chacun·e peut demander une visite auprès du service de médecine de prévention sans restriction (Art 24 – 2 du décret 82 – 453) sur le temps de travail et sans que l’administration n’ait à en connaître le motif.
a/Personnels fonctionnaires ou contractuels de droit public dont la durée du contrat est supérieure à 12 mois
Pour ces personnels, il s’agit de la visite médicale d’information et de prévention.
Comment la demander ?
Faire une lettre (voir encadré) adressée à son ou sa chef·fe d’établissement (proviseur·e, principal·e, IEN, président·e d’université…), responsable de la santé des agent·es qui travaillent dans son administration. La demande est individuelle, mais vous pouvez vous regrouper entre collègues pour faire un envoi en nombre.
Demander un récépissé auprès du secrétariat du ou de la chef·fe d’établissement ou de l’IEN*.
Acter cette demande dans le Registre de santé et sécurité au travail (RSST*) présent dans toutes les écoles, dans tous les EPLE*, dans tous les services : rédigez une phrase courte où vous faites état de votre demande.
b/Personnels contractuels de droit privé et personnels contractuels de droit public dont la durée du contrat est inférieure à 12 mois
Pour ces personnels, il s’agit de la visite médicale du travail.
Le rôle et le champ d’intervention du médecin du travail
Dans ses articles L4624‑1 et suivants, le Code du Travail définit le rôle de la médecine du travail :
« […] proposer des mesures individuelles […] des transformations de postes, justifiées par des considérations relatives à l’âge […] à l’état de santé physique et mentale […]. L’employeur est tenu de prendre en considération ces propositions […] »
« La ou le salarié·e bénéficie d’examens médicaux périodiques, au moins tous les 2 ans […] Le premier de ces examens a lieu dans les 2 ans suivant l’examen d’embauche ».
« Les examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée sont renouvelés au moins une fois par an ».
« Bénéficient d’une surveillance médicale renforcée :
- les salariés affectés à certains travaux comportant des risques […] ou certains modes de travail […]
- les salariés qui viennent de changer de type d’activité […], les travailleurs handicapés […], les femmes enceintes […], les mères dans les 6 mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement […], les travailleurs de moins de 18 ans »
« Le salarié bénéficie d’un examen de reprise de travail […] :
- après un congé de maternité
- après une absence pour cause de maladie professionnelle
- après une absence d’au moins 8 jours pour cause d’accident du travail
- après une absence d’au moins 21 jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel
- en cas d’absences répétées pour raison de santé.
« L’examen de reprise a pour objet d’apprécier l’aptitude médicale du salarié à reprendre son emploi, la nécessité d’une adaptation des conditions de travail […]. Cet examen a lieu lors de la reprise du travail ou au plus tard dans un délai de 8 jours »
Modèle de courrier à recopier pour la demande de visite médicale de prévention
NOM, Prénom, fonction Adresse du lieu de travail
À : M./Mme le ou la chef·fe d’établissement ou de service (IEN, principal·e, proviseur·e…)
Objet : demande de visite médicale de prévention
Madame, Monsieur,
Conformément à la loi et notamment au Décret 82 – 453 du 28 mai 1982/Code du travail, j’ai l’honneur de vous demander le bénéfice de la visite médicale de prévention.
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à mon attachement au service public d’éducation.
Signature
Les médecins de prévention doivent exercer une surveillance médicale particulière (au moins annuelle) à l’égard des agent·es concerné·es par le handicap, la grossesse, l’accouchement, l’allaitement, des agent·es réintégré·es après un congé longue maladie ou de longue durée, ou souffrant de pathologies particulières ou enfin d’agent·es occupant certains postes spécifiques. Les médecins de prévention sont soumis·es au secret médical et ne peuvent divulguer des informations concernant la santé des agent·es à l’employeur sans leur accord. Elles et ils doivent formuler auprès de l’employeur des demandes d’adaptation du poste ou d’octroi de congé longue maladie ou longue durée, le cas échéant (Art 24 du décret 82 – 453).
Les références réglementaires
- Articles 8 à 28 – 2 du Décret 82 – 453
SUD éducation revendique :
- La création d’une médecine de prévention digne de ce nom dans l’Éducation Nationale qui puisse exercer correctement l’ensemble de ses missions ;
- Un grand plan national d’embauche massive de médecins du travail en nombre suffisant dans toutes les académies et universités ;
- Pour l’ensemble des personnels une visite médicale annuelle afin de tracer nos expositions aux risques professionnels et bénéficier des adaptations de postes le cas échéant ;
- Le respect des préconisations médicales et l’octroi effectif d’allègements de service chaque fois que le ou la médecin du travail le préconise.
3.2 - Le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP*) et l’évaluation des risques professionnels
Le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP*) est un document obligatoire en application des articles articles R4121‑1 et R4121‑2 du code du travail, que les employeurs doivent mettre en place. Ces DUERP* jouent un rôle central dans la prévention des risques professionnels sur les lieux de travail. Le but du DUERP* est de lister, par unité de travail, l’ensemble des risques professionnels auxquels les personnels peuvent être exposé·es et surtout de prévoir des actions de prévention pour faire cesser le risque, ou à défaut le diminuer au maximum. L’élaboration du DUERP* doit prendre en compte les personnels du service (école, établissement du second degré, DSDEN*, rectorat, université…). Le DUERP* doit obligatoirement être genré : les risques professionnels listés doivent prendre en compte le genre. Le DUERP* est un document qui a vocation à vivre et à faire vivre une démarche de prévention des risques professionnels, ils doivent être actualisés tous les ans. Syndicalement, il est important de se saisir de cet outil pour défendre les conditions de travail et la prévention de santé sur les lieux de travail.
Si les DUERP* sont mentionnés dans les textes réglementaires depuis une vingtaine d’années, force est de constater que dans un certain nombre de services ils n’existent pas, et quand ils existent, ils ne sont pas mis à jour et ont fini au fond d’un tiroir ou dans les limbes d’un ordinateur. L’administration ne met pas les moyens suffisants pour mettre en œuvre les DUERP*. A partir des risques identifiés dans les DUERP*, l’employeur doit produire des programmes annuels de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail (PAP ou PAPRIPACT*), en somme la feuille de route élaborée pour prévenir les effets des risques professionnels sur la santé et la sécurité sur le lieu de travail. SUD éducation exige de l’administration que les plans de prévention soient mis en place mais surtout appliqués ; et que lorsqu’il y a des mesures à prendre, l’administration mette en regard la ligne budgétaire correspondante.
Les références réglementaires
- Articles R4121‑1 à R4121‑4 du Code du travail
- Article R 253 – 21 du Code Général de la Fonction Publique
- Circulaire du 11 juin 2024 [NOR : TFPF2413788C]
Les revendications de SUD éducation
SUD éducation revendique que l’employeur respecte enfin la loi. Il lui incombe de :
- supprimer les risques qui peuvent l’être.
- mettre en œuvre tous les moyens pour éviter les risques.
- évaluer les risques qui ne peuvent être évités, y compris environnementaux et psycho-sociaux, et en élaborant les DUERP* genrés de chaque école et établissement. C’est sa responsabilité, et non celle des directeur·ices d’école.
- dégager du temps de concertation sur le temps de travail pour que les équipes puissent contribuer à l’état des lieux, après quoi l’employeur et les préventeur·ices définiront les actions et moyens à mettre en œuvre.
- prendre des mesures de protections collective, avec les moyens nécessaires
- assurer la mise à jour régulière des DUERP* et leur communication à l’ensemble des personnels
Les mesures de protection sont mises en place lorsque les mesures de prévention portant sur l’élimination ou la réduction du risque ne sont pas suffisantes.
Les mesures de protection apportées par l’employeur ne doivent pas être uniquement individuelles, les équipements de protection collective doivent primer sur les équipements de protection individuelle.
La protection collective vise à limiter ou éviter l’exposition au danger des salarié·es, en réduisant la probabilité de rencontre avec le danger. Les équipements de protection collective permettent de protéger l’ensemble des salariés et sont dans ce sens à privilégier.
Quatre principes régissent les moyens de protection collective : la protection par éloignement (balisage, déviation…), la protection par obstacle (rambarde de sécurité…), la protection par atténuation d’une nuisance (insonorisation du local, encoffrement de la pièce usinée, aspiration de poussière, ventilation…), la protection par consignation d’une fonction dangereuse lors d’interventions (appareil mis hors tension avant intervention…).
Exemple : la mauvaise acoustique d’un gymnase génère des troubles auditifs pour les enseignant·es. La protection apportée par des bouchons d’oreille n’est qu’une mesure de protection individuelle temporaire ; la mesure de protection collective vise à supprimer la cause pour l’ensemble des usager·es et des personnels par des travaux d’isolation phonique adéquats.
Les équipements de protection individuelle (EPI*) sont destinés à protéger les travailleur·ses contre un ou plusieurs risques professionnels. Leur utilisation ne doit être envisagée qu’en complément des autres mesures d’élimination ou de réduction des risques. C’est à partir de l’évaluation des risques menée dans l’établissement (DUERP*) que doit être engagée la réflexion relative à l’utilisation des EPI*. Les EPI* comme les chaussures de sécurité, les lunettes de protection, ou les systèmes d’arrêt des chutes permettent de protéger contre des risques de diverse nature (mécanique, biologique, chimique…). C’est particulièrement important dans l’enseignement professionnel. Si un certain nombre d’établissements les fournissent, ce n’est pas encore le cas partout. De nombreux établissements traînent les pieds sous des prétextes divers dont l’absence de dotation financière… alors que les rectorats, lorsqu’ils sont questionnés sur le sujet, précisent que chaque établissement a reçu l’argent nécessaire.
Ils ne peuvent pas se substituer aux mesures de protection collective. Trop souvent les mesures de protection collective ne sont pas prises, au prétexte que des mesures de protection individuelle ont été mis en place. En lycée professionnel, des EPI* et EPC* (équipements de protection collectifs : ventilation des particules bois, coupe-circuits d’urgence, etc.) sont obligatoires dans les ateliers, en particulier dans les filières industrielles.
Pour chaque machine et chaque situation de travail à l’atelier, une fiche de sécurité est obligatoire et elle doit mentionner les EPI* et EPC* qui doivent être utilisés. La réalisation des fiches, et plus généralement les dispositifs de sécurité doivent être définis par une analyse des risques préalables, réalisée sous la direction du DDFPT* (Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques – voir 3.2.3 de ce guide).
Les EPC* doivent être installés par l’établissement, sous la direction du DDFPT*.
Les EPI* pour l’ensemble des personnels, enseignant·es ou non, doivent être fournis par l’établissement, qui lui-même doit se tourner vers le rectorat pour un financement, car c’est à l’employeur de payer les EPI*.
Les références réglementaires
- article L. 4121 – 1 et article L4121‑2 du Code du travail
Les revendications de SUD éducation
SUD éducation revendique que :
- les mesures de prévention collective soient mises en place,
- les équipements de protection individuelle (EPI*) qui sont dus aux personnels : tenues de travail, gants, chaussures, protections auditives, leur soient fournis aux frais de l’employeur
SUD éducation rappelle que les mesures de protection collective doivent primer sur les mesures de protection individuelles, exige que la loi s’applique et encourage les personnels à la faire respecter. Pour cela, tou·tes les agent·es peuvent agir en écrivant dans les registres de santé et sécurité au travail les manquements et défaillances, et en exerçant leur droit de retrait lorsque leur protection n’est pas assurée.
4 - Les possibilités d’alerte : mettre l’employeur face à ses responsabilités
La loi 83 – 634 dite loi Anicet Le Pors définit les droits et obligations des fonctionnaires et assimilé⋅es (contractuel⋅les, etc) dit dans son article 23 que « des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur sécurité et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ». Le récent Code général de la fonction publique a repris les dispositions de la loi 83 – 634, l’ancien article 23 est maintenant codifié en article L136‑1 du Code général de la fonction publique.
C’est l’employeur qui porte la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnels, ce qu’il faut inlassablement lui rappeler. Sur le terrain, l’employeur est représenté par les chef·fes de services.
Les lois Auroux en 1982 introduisent pour les travailleur·euses un droit d’expression, repris dans le code du travail à l’article L2281‑1 « Les salariés bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail ». Ce droit d’expression se traduit dans la fonction publique par l’existence d’un registre qui contient les observations et suggestions des agents relatives à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail.
Ce droit d’expression se traduit dans la fonction publique par l’existence du Registre santé et sécurité au travail, le RSST*.
Ce registre est un document obligatoire, qui doit être présent sur tous les lieux de travail. Il doit être accessible à tous·tes à tout moment et situé dans un lieu hors de pression hiérarchique. Un affichage clair et précis indiquant sa localisation doit être mis en place. Il peut y avoir deux registres dans certains établissements, un destiné aux usager·ères et un autre aux agent·es, comme le recommande la DGAFP*.
L’administration (IEN* dans le premier degré, chef·fe d’établissement dans le second degré) est tenue d’apporter une réponse aux signalements inscrits dans ce registre. La CHS* (Commission Hygiène et Sécurité) ou le CA* (Conseil d’Administration), le conseil des maitres·ses peuvent se saisir des observations au registre et les mettre à leur ordre du jour.
Voici quelques exemples de problèmes qui peuvent y être soulevés : organisation pathogène, problèmes matériels, risques environnementaux, risques psychosociaux, conditions de travail…
Comment l’utiliser ?
Les faits doivent être relatés simplement, le plus objectivement possible, sans jugement ni commentaire. Il ne faut pas hésiter à le remplir collectivement. Ne pas hésiter non plus à se tourner vers SUD éducation pour solliciter une aide à la rédaction.
La description peut être accompagnée de documents agrafés ou de pièces jointes (comme des photos ou un rapport d’incident) et de propositions de solution ou d’amélioration. Dans le cas d’un registre dématérialisé, on peut les envoyer en pièce jointe, ou les envoyer par mail aux destinataires du signalement. Il doit être visé régulièrement par l’agent·e de prévention (qui est chargé·e de sa tenue) et par le/la chef·fe d’établissement ou IEN* (qui est chargé d’apporter des réponses), et que son contenu soit transmis aux F3SCT* départementales et académiques, à la F3SCT* de l’université ou celle du conseil départemental ou régional pour les agent·es. Dans le premier degré, pour les RSST* qui ne sont pas dématérialisées, une fois la fiche rédigée, il est possible de l’envoyer par mail aux destinataires suivants : IEN*, Assistant de prévention de la circonscription, élu·es F3SCT* académique et départementale, et de l’accompagner des pièces jointes utiles.
Dans les EPLE* du second degré dotées d’une CHS*, il doit être consulté en commission tous les trimestres. Dans tous les cas, ce registre, qui fait foi en justice, est une preuve juridique des problèmes constatés, comme par exemple dans le cadre des reconnaissances d’accidents et maladies professionnelles. Le/la chef·fe d’établissement ou l’IEN*, en tant que chef·fe de service, est responsable de la santé, de la sécurité et des conditions de travail des personnels qui lui sont confiés. Il/elle doit trouver des solutions ou en référer à sa hiérarchie.
Le RSST* est un outil au service d’une stratégie syndicale permettant de construire un rapport de force au sein des établissements et vis-à-vis de l’employeur. Il ne constitue pas une fin en soi et s’inscrit dans un cadre plus large d’actions syndicales permettant d’inverser le rapport de force existant. Il permet de se réapproprier un pouvoir d’agir collectivement.
Les références réglementaires
Les revendications de SUD éducation
- Lorsqu’il existe un registre en version numérique, celui-ci doit coexister avec le registre papier afin notamment que les usager·es puissent le remplir.
- L’administration doit prendre en compte toutes les fiches RSST* et les transmettre in-extenso aux membres des F3SCT*, au fil de l’eau
- Les chef·fes de service doivent apporter une réponse à toutes les fiches, avec des solutions réelles et concrètes aux problèmes soulevés.
- Les risques signalés doivent être traduits dans les DUERP* afin d’être pris en compte dans une véritable politique de prévention des risques professionnels.
« L’agent alerte immédiatement l’autorité administrative compétente de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection. » (Article 5 – 6 du décret n°82 – 453)
Il peut exister un registre de danger grave et imminent (RDGI*) dans les circonscriptions, les collèges, les lycées, les universités, et c’est ce que revendique SUD éducation. Si ce registre n’existe pas, cela n’empêche pas l’agent d’alerter par tout moyen à sa disposition.
Un danger grave et imminent peut être constitué lorsque la personne est en présence d’une menace susceptible de porter une atteinte sérieuse à son intégrité physique ou à sa santé, dans un délai rapproché. Les risques à effet différé sont aussi concernés, comme l’exposition à l’amiante ou au radon qui peut faire émerger des pathologies bien après l’exposition au risque.
Ces situations et ces démarches, peu fréquentes et complexes, nécessitent un accompagnement syndical par SUD éducation.
L’administration devra réagir immédiatement pour éviter la réalisation de l’accident par la remise en conformité, l’évacuation des personnes, des mesures de modification de l’organisation du travail… Si, faute d’action, un accident se produit dans ces circonstances, le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur sera acquis pour la victime dans le cas où celle-ci n’est pas fonctionnaire, ce qui permet une meilleure indemnisation de celle-ci. Dans la fonction publique, il existe une jurisprudence permettant une réparation intégrale du préjudice dans le cas où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité ou de l’état (arrêt Moya Caville du Conseil d’État).
L’agent·e qui a “un motif raisonnable de penser que [la situation] présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé” peut se retirer de sa situation de travail si il ou elle estime cela nécessaire, sans qu’il y ait sanction financière ou autre : c’est le droit de retrait. Pour le faire valoir, il suffit de le signaler à son/sa chef·fe de service. Il est possible de le faire verbalement en cas d’urgence, mais nous conseillons vivement de le faire par écrit pour laisser une trace. S’il existe, le registre de danger grave et imminent doit être complété.
Il est utile de rappeler qu’en cas de violence au sein d’un établissement scolaire, un certain nombre de collègues n’ont pas hésité à utiliser ce droit de retrait, à juste titre. Attention : l’exercice du droit de retrait ne doit pas entraîner un danger pour autrui ! Par ailleurs, le droit de retrait est un droit individuel. Quand plusieurs agent·es le font valoir pour le même motif, il faut que chacun·e le signale individuellement.
Quelques exemples qui peuvent entraîner un droit de retrait : travaux aux abords de l’établissement qui provoquent des vibrations dans le bâtiment ; grue implantée aux abords de l’établissement ; bruits de travaux d’une intensité sonore importante qui perturbent le déroulement normal d’un cours (risque de surdité…) ; élève violent·e dans un groupe classe ; menaces émises par un·e élève ou une autre personne ; machines mal isolées électriquement ; sol glissant ; utilisation de produits (solvants, peinture…) sans ventilation, tir au fusil d’une personne vers la cour de récréation, présence d’amiante, taux de radon anormal (gaz naturel radioactif)…
SUD éducation a construit des outils pour accompagner les personnels dans les signalements de danger grave et imminent et le droit de retrait. Afin de protéger vos droits individuels et les droits collectifs au sujet du droit de retrait, faites-vous accompagner par votre syndicat SUD éducation.
4.2.3 - Le droit d’alerte des représentant·es en Formation spécialisée santé sécurité et conditions de travail (F3SCT*)
Le droit d’alerte lorsqu’il est exercé par un membre de la F3SCT* a des implications différentes, en particulier cela déclenche une enquête immédiate conjointe du représentant de la formation spécialisée qui a signalé le danger ou un autre membre de la formation spécialisée avec le chef de service. A l’issue de cette enquête, l’employeur doit proposer des mesures pour faire cesser le danger. En cas de divergence entre les représentant·es des personnels et l’employeur sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, une réunion extraordinaire de la F3SCT* doit avoir lieu au plus tard dans les 24 heures. Si le désaccord persiste après celle-ci, alors il est possible de solliciter l’Inspection du Travail.
Les références réglementaires
- article 5 – 6 du décret 82 – 453 (droit d’alerte agent·es et droit de retrait)
- articles R253-58 et suivants du Code général de la Fonction publique (droit d’alerte des représentant·es en F3SCT)
Les revendications de SUD éducation
SUD éducation revendique que :
- Les droits de retraits et signalements de Danger grave et imminents soient reconnus par l’administration ;
- les droits d’alertes des membres des différentes F3SCT* soient pris en compte ;
- les délais réglementaires en cas de droit d’alerte et droit de retrait soient respectés.
4.3.1 - Les cellules de recueil et de traitement des signalements de violences, discriminations, harcèlement et agissements sexistes (VDHAS*) ou de violences sexistes et sexuelles (VSS*)
La circulaire du 9 mars 2018 oblige l’employeur à la mise en œuvre d’un dispositif de signalement et de traitement des violences sexuelles et sexistes. Il aura fallu attendre 2024 pour que l’Éducation nationale, sous la pression syndicale, se mette enfin en conformité avec ce texte.
Pourtant, selon les académies et selon les situations, le traitement des violences sexistes et sexuelles au travail reste très hétérogène et les personnels d’encadrement et de direction, peu formé·es, font trop souvent peser sur les victimes le poids de leur témoignage, quand ils ne remettent pas en cause leur parole. La formation des écoutant·es et des membres composant la cellule (le plus souvent des personnels RH du rectorat) semble souvent sommaire.
Dans la plupart des cas, ce dispositif est appelé cellule de recueil et de traitement des signalements, selon les endroits, des VSS* ou des VDHAS*. Ces dispositifs peuvent être contactés par les victimes et les témoins des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et d’agissements sexistes au travail.
Ces cellules doivent communiquer largement sur les moyens de leurs saisines, et généralement, sur les coordonnées des services et des professionnels accessibles aux personnels. Le texte rappelle enfin les exigences du secret professionnel (ou de l’obligation de discrétion professionnelle), ainsi que les règles de confidentialité et de protection des données personnelles.
Les cellules prennent en charge trois procédures :
- le recueil des signalements. Les victimes et les témoins peuvent saisir la cellule par un appel à un numéro dédié, ou par un mail à l’adresse électronique de la cellule, ou par un formulaire en ligne. L’anonymat est garanti aux victimes et aux témoins si elles et ils le souhaitent lorsqu’elles procèdent au signalement.
- l’orientation et le suivi vers les services et professionnel·les compétent·es, qui assureront l’accompagnement des victimes ou témoins et leur soutien.
- l’orientation et le suivi des victimes ou témoins vers les autorités hiérarchiques compétentes. Celles-ci doivent prendre toute mesure appropriée, y compris conservatoire, et assurer le traitement des faits signalés. Pour toutes les suites qui ne relèvent pas du pénal, l’accord exprès de l’intéressé·e est obligatoire. La personne qui a réalisé le signalement doit recevoir une information écrite des mesures prises avant qu’elles ne soient mises en œuvre.
Ces mesures peuvent amener l’administration à :
- “diligenter, le cas échéant, une enquête administrative dans les plus brefs délais”
– ouvrir une procédure disciplinaire
– accorder et mettre en œuvre, si les conditions sont réunies, la protection fonctionnelle
– si le rapport de la cellule d’écoute conclut à la présomption de faits pénalement répréhensibles, aviser le procureur de la République “dans le cadre de l’article 40 du code de procédure pénale.” Cette démarche s’ajoute aux procédures entamées et aux décisions prises par l’autorité hiérarchique. Elle n’annule en aucun cas, les obligations de protection des victimes des administrations centrales.
Attention : ces quatre dernières procédures supposent la levée de l’anonymat, qui est garanti dans la première partie de la procédure (recueil du signalement).
Les équipes de SUD éducation peuvent vous conseiller des associations spécialisées en droits des femmes et des personnes LGBTQIA+ qui pourront vous écouter, vous conseiller et vous orienter (notamment vers des avocat·es ou des structures médico-judiciaires si vous le souhaitez). Le conseil d’un·e avocat·e peut toutefois engager des coûts financiers importants, assurez-vous auprès de la cellule de la mise en place d’une convention entre l’employeur et l’avocat·e choisi·e.
Les textes réglementaires
Articles R135‑1 à 10 du Code général de la fonction publique
Les revendications de SUD éducation
Après avoir porté ce sujet pendant de nombreuses années et avoir accompagné de nombreuses victimes de violences sexistes et/ou sexuelles maltraitées par la hiérarchie, la publication de ce texte était une victoire syndicale. Mais il reste encore beaucoup à faire sur le terrain pour l’application effective de ce texte et notamment il reste à gagner :
- une véritable mise en place de ces cellules sur le terrain avec des personnels formés,
- la création d’une cellule d’écoute spécifique aux violences sexistes et sexuelles (VSS*)
- des campagnes d’information, de prévention et de formation notamment pour les représentant·es du personnel, ainsi que pour les personnels d’encadrement qui ont tendance à oublier leurs obligations,
- des moyens avec des autorisations d’absence pour permettre un accompagnement médico-social, des possibilités de mutation pour les victimes qui en ont besoin.
Dans chaque service, il doit y avoir un·e assistant·e de prévention qui a pour mission de conseiller et d’accompagner les chef·fes de service sur toutes les questions de santé et de sécurité au travail et qui peut également être une ressource pour les personnels. Elles et ils sont notamment chargé·es de veiller à la bonne tenue du registre de santé et sécurité au travail (voir 3.1). Ces assistant·es de prévention doivent bénéficier d’une formation adaptée, et disposer d’une lettre de mission.
Il existe dans le premier degré des assistant·es de prévention de circonscription (APC*), et dans le second degré des assistant·es de prévention d’établissement (APE*). Dans les EPLE*, il y a également un·e deuxième assistant·e de prévention nommé·e pour le compte de la collectivité territoriale.
Ces agents manquent généralement de temps de décharge pour mener à bien leurs missions de façon satisfaisante. La direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP*) préconise que les assistants et conseillers de prévention disposent respectivement d’au moins 20% et 50% de leur temps de travail consacré à leur mission de prévention des risques professionnels, mais c’est rarement le cas.
Les missions des assistant·es de prévention sont coordonnées par des conseiller·es de prévention qui travaillent dans les DSDEN* et les rectorats. Iels ont également des missions de conseil auprès des Dasen et des Recteur·ices.
Les textes réglementaires
article 4.1 du décret 82 – 453, guide de la DGAFP d’accompagnement de ce décret.
En lycée polyvalent ou en lycée professionnel, le/la Directeur·ice Délégué·e aux Formations Professionnelles et Technologiques (DDFPT*) tient un rôle important en matière d’hygiène et sécurité. Il/Elle est un·e conseiller·e du/de la chef·fe d’établissement et fait partie intégrante de l’équipe de direction. Parmi ses missions, il/elle doit notamment assurer le suivi de la mise en œuvre et du maintien en conformité des équipements pédagogiques, et doit également assurer des démarches de prévention des risques professionnels. Ces missions s’appliquent pour les élèves, mais aussi pour les personnels. Plus généralement, les chef·fes d’établissement lui délèguent régulièrement des missions concernant la sécurité au sein de l’établissement (exercice incendie, …)
Les références réglementaires :
Dans le secteur privé, l’inspection du travail exerce ses missions en toute indépendance vis-à-vis des employeurs et employeuses. Les inspecteurs et inspectrices du travail bénéficient de garanties d’indépendance et de prérogatives en matière de sanctions des infractions au Code du travail.
Dans la fonction publique, ce sont les inspecteur·trices santé et sécurité au travail (ISST*) qui veillent à l’application par l’employeur des règles relatives à la protection de la santé et de la sécurité des agents dans leur travail. Leur indépendance est toute relative, car les ISST* sont désigné·es par les recteur·trices d’académie et malgré leur rattachement à l’inspection générale, restent sous leur influence. L’État s’est ainsi soustrait du champ de contrôle de l’Inspection du travail et s’est bien gardé de leur attribuer un pouvoir de sanction sur ses propres carences. Les ISST* ont donc uniquement une fonction d’expertise, de conseil et de proposition.
Le rôle de l’ISST* est de contrôler l’application de la réglementation en matière d’hygiène, santé, sécurité et condition de travail dans l’Académie où il·elle est nommé·e. L’ISST* procède à des inspections dont il ou elle organise le programme sur l’année ; a un rôle de conseil en matière d’hygiène santé, sécurité et condition de travail envers l’administration et sur les lieux de travail (école, établissement, services) ; rédige des rapports qu’il ou elle adresse à l’administration assortis de préconisations que l’administration est censée suivre. En cas d’urgence et d’accident grave, l’ISST propose des mesures immédiates au chef·fe de service intéressé·e qui leur rendra compte des suites données, mais n’a pas le pouvoir de les contraindre à prendre ces mesures.
L’ISST* peut être saisi·e par les personnels qui pensent que leur situation de travail présente un risque pour leur santé ou mettent en jeu les conditions de travail. L’ISST* peut participer aux visites de site, aux enquêtes et assister aux réunions de la F3SCT* à laquelle il remet un rapport annuel sur ses activités, et qu’il tient informée de toutes ses visites et observations. En cas de désaccord suite au signalement d’un danger grave et imminent par un membre de la F3SCT*, L’ISST* est averti·e de la réunion qui se tient en urgence.
Par ailleurs, la règle d’un ISST* par académie semble bien insuffisante quand ils et elles couvrent à elleux seul·es un périmètre comptant plusieurs centaines d’établissements et parfois plusieurs dizaines de milliers de personnel, et ce sans moyen coercitif.
Les textes réglementaires
articles 5 (5 – 1 à 5 – 5) du décret n°82 – 453,
articles R253-32, R253-45, R253-59, R253-51, R254-24, R254-25, R 251 – 30 du Code générale de la fonction publique
Les revendications de SUD éducation
Pour assurer la santé et la sécurité des personnels, l’ISST* doit voir son indépendance garantie et ses moyens renforcés, c’est pourquoi SUD éducation revendique :
- l’intégration des ISST* dans le corps de l’inspection du travail
- le recrutement massif d’inspectrices et inspecteurs du travail pour contrôler et sanctionner les manquements
- l’application des règles relatives à la protection de la santé et de la sécurité des agent·es de l’Éducation nationale.
Il existe plusieurs niveaux d’instances organisées par l’administration et dont on peut se servir pour faire valoir nos droits en terme de santé, sécurité et conditions de travail : les formations spécialisées des CSA* académiques et départementaux, ou des universités, et les CHS* dans les EPLE*
Les formations spécialisées en matière de santé, sécurité et conditions de travail (F3SCT*) ont pour mission de contribuer à l’amélioration des conditions de travail. Elles sont chargées de la prévention en matière de santé, sécurité, hygiène et conditions de travail.
Les F3SCT* ont été créées en 2020 pour remplacer les anciens CHSCT*. Elles sont issues des CSA*, et sont compétentes sur les périmètres des CSA* dont elles émanent : départemental, académique ou ministériel. Comme les CHSCT* avant elles, les F3SCT* héritent de périmètres beaucoup trop larges, à l’échelle du département, de l’académie ou du ministère tout entier : comme le nombre d’agent·es censé·es y être représenté·es s’élève à plusieurs milliers ou dizaines de milliers, il est difficile de leur faire remplir toutes leurs fonctions.
L’histoire des CHSCT*
En 1982, les lois Auroux donnent aux commissions d’hygiène et de sécurité du privé, les CHS, créées en 1947, le droit de se pencher sur les conditions de travail des salarié·es. Les CHS deviennent alors des CHS-CT. Les lois Auroux les affranchissent aussi du Comité d’entreprise, dont elles dépendaient étroitement auparavant, pour en faire des institutions représentatives du personnel à part entière. Mais l’État-patron, tout « socialiste » qu’il fût, décide qu’en ce qui concerne « ses » salarié·es, celles et ceux de la fonction publique, il peut se permettre de déroger au Code du travail : il n’y aura pas de CHS-CT pour les fonctionnaires !
De 1982 à 2011, il n’existe alors que des Commissions d’hygiène et de sécurité qui sont paritaires – l’administration et les élu·es syndicaux·les y disposent d’autant de voix – et dépourvues de toute une série de prérogatives qu’ont obtenues les CHS-CT du privé. Dans le public : pas de droit d’alerte, pas de délit d’entrave, pas de pouvoir d’expertise, pas de recours à l’inspection du travail, etc.
En 2009, un accord sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique est signé, mais il ne sera traduit seulement qu’en 2011 par un décret, qui créera enfin les CHSCT dans la fonction publique.
Cet accord, notre Union syndicale Solidaires a refusé de le ratifier, car nombre de dispositions présentes dans le Code du travail et favorables aux salarié·es n’y figuraient pas. C’est le cas par exemple du délit d’entrave ou d’un corps d’inspection du travail totalement indépendant de l’employeur. Cet accord a donc permis encore une fois à l’État-patron de s’exonérer de certaines obligations qu’il impose par ailleurs aux employeurs du secteur privé.
En 2018, les ordonnances Pénicaud ont supprimé les CHSCT* dans le secteur privé, et en 2020, le gouvernement Macron publie les nouveaux textes qui transforment les instances représentatives des personnels dans la fonction publique, transformant les CHSCT* en F3SCT* dès les élections professionnelles de 2022.
Il aura fallu trente ans pour que le secteur public accorde aux fonctionnaires des droits existants dans le privé, et seulement quatre ans pour les supprimer pour tou·te·s !
Dans cette situation, il ne s’agit pas de regarder passer les attaques ou de déplorer les conséquences mais bel et bien de passer à l’offensive et de mener des luttes sur ces sujets essentiels. Dans toutes ces batailles les solidarités et les collectifs sont essentiel·les. Poursuivons les combats !
Malgré le fait que les textes aient amoindri leurs prérogatives par rapport aux CHSCT*, les Formations spécialisées en santé, sécurité et conditions de travail (F3SCT*) restent des instances où l’action syndicale est possible. Ce ne sont pas des instances paritaires : les représentant·es du personnel, désigné·es par les organisations syndicales en fonction de leur représentativité en CSA* sont les seul·es à y avoir le droit de vote. Et les avis émis par une F3SCT*, comme les procès-verbaux de ses séances, sont autant de preuves pouvant être opposées à l’employeur devant les tribunaux en cas d’action juridique.
En vertu de l’article R. 253 – 58 du Code général de la fonction publique,les membres de la F3SCT* disposent d’un droit d’alerte qui leur permet de signaler un danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des agent·es, et qui oblige l’employeur à y apporter une réponse (voir 3.2.3) Pour cela, elles et ils peuvent s’appuyer sur les registres santé et sécurité au travail (RSST*), obligatoires dans tous les services, les écoles et les établissements scolaires et universitaires.
La F3SCT* peut aussi déclencher des enquêtes en cas d’accident grave ou de maladie professionnelle, notamment les suicides ou tentatives de suicides. Les enquêtes ont pour objectif de comprendre les liens entre travail et accident ou maladie, pour empêcher que ces atteintes à la santé surviennent à nouveau grâce à la prévention des risques.
Enfin, la F3SCT* peut effectuer au moins 3 visites par an, sur des lieux de travail qu’elle choisit dans son périmètre. Ces visites rendent possible une analyse des situations de travail et amènent à la rédaction d’un rapport de visite accompagné de préconisations pour améliorer les conditions de travail et planifier la prévention.
Enquêtes et visites permettent donc de parler des conditions de travail réelles des personnels pour mettre l’administration devant ses responsabilités. C’est en tout cas dans cette optique de contre-pouvoir que SUD éducation use de cette instance.
En effet, la prise en compte des conditions de travail en F3SCT* est un point d’appui pour notre syndicalisme : elle permet de porter la question du travail, de son sens, de son organisation, au sein même de ces instances, face à l’employeur. C’est l’occasion d’y dénoncer les restructurations, d’y mettre en accusation les dérives du management toxique et du new public management (voir chapitre 1.2.1) dans le service public d’éducation, comme le poids néfaste de la soumission hiérarchique et de pointer leurs conséquences pour les personnels. Pour nous, il faut d’ailleurs toujours articuler cela avec l’action collective, avec les luttes et le rapport de force.
Parmi les représentant·es des personnels siégeant en F3SCT* est désigné·e un·e référent·e VSS* ou VDHAS*. Si l’administration donne peu de poids à son rôle dans le pilotage de la politique de prévention des VSST*/VDHAS*, ce sont des militant·es qui peuvent aussi recueillir les signalements des victimes ou des témoins, et interpeller l’administration à ce sujet.
Dans le second degré, des Commissions hygiène et sécurité – CHS* – d’EPLE* existent mais sans avoir toutes les prérogatives des F3SCT* : elles sont des commissions issues du conseil d’administration (CA*) et l’administration a le droit de vote dans cette instance consultative, comme ses autres membres.
Dans quels établissements les CHS* sont-elles obligatoires ?
Les CHS* sont obligatoires seulement dans les lycées professionnels et les lycées polyvalents, les lycées généraux s’ils comportent des sections d’enseignement technique, les établissements régionaux d’enseignement adapté (Érea*), les collèges accueillant une Segpa*. Mais une circulaire de 1993 précise toutefois que la mise en place d’une CHS* est « vivement conseillée dans l’ensemble des Lycées et Collèges d’enseignement général ».
Pourtant, si le Code du travail était respecté, c’est à partir de 50 salarié·es que devrait être créé un CSA*, et dès 250 salarié·es, une F3SCT* émanant du CSA*. Concrètement, cela signifierait que la quasi-totalité des lycées, lycées professionnels, collèges et des circonscriptions du 1er degré devraient avoir au moins un CSA*, et dans de nombreux cas une F3SCT* dédiée. Qui d’autre que les personnels sait ce qu’elles et ils vivent au quotidien ? Nous réclamons la création de CHS partout, y compris dans les établissements et dans les circonscriptions du premier degré où elles ne sont pas obligatoires.
Dans le premier degré, le conseil d’école peut légitimement constituer l’équivalent de la CHS* du second degré. Pour cela, la mise à l’ordre du jour systématique d’un point sur la santé et les conditions de travail des personnels est à imposer.
Qui peut participer aux réunions des CHS* ?
La liste des membres de la commission doit être affichée dans des lieux visibles de tous·tes, usagèr·es, élèves comme personnels. Les membres de la CHS* et leurs suppléant·es sont désignés par les représentant·es respectifs·ves siégeant au Conseil d’administration.
Il s’agit de :
- représentant·es de l’administration : le·la chef·fe d’établissement, son adjoint·e, l’adjoint·e gestionnaire, un·e CPE, le·la chef·fe de travaux ;
- 2 représentant·es des personnels enseignant·es et de vie scolaire ;
- représentant·es des personnels non enseignant·es (personnels administratifs et d’entretien) : 1 personne, ou 2 si l’effectif de l’établissement est supérieur à 600 élèves ;
- 2 représentant·es des élèves ;
- 2 représentant·es des familles ;
- un·e élu·e de la collectivité territoriale de rattachement ;
- l’infirmier·e ;
- un·e assistant·e de prévention de l’établissement par employeur (voir 3.3.2).
Le·la chef·fe d’établissement est président·e de la CHS*, tandis que l’adjoint·e gestionnaire est chargé·e de la préparation et de la coordination des travaux de la CHS*. C’est aussi lui ou elle qui doit mettre en oeuvre les mesures proposées par la CHS* et éventuellement adoptées en CA*.
Le médecin de prévention et l’inspecteur·ice santé et sécurité au travail du rectorat (ISST*) peuvent assister également aux réunions de la CHS* en tant que “personnes qualifiées”, tout comme l’inspecteur·ice du travail ou le·la conseiller·e de prévention académique et départemental·e.
Quel est le fonctionnement des CHS*, et quelles sont leurs prérogatives ?
La commission doit se réunir au moins une fois par trimestre, à l’initiative du ou de la cheffe d’établissement. Elle peut se réunir plus fréquemment si la situation l’exige. Notamment, une séance extraordinaire sur un ordre du jour précis peut être demandée par le CA*, le conseil des délégué·es des élèves, le·la représentant·e de la collectivité, le·la chef·fe d’établissement, ou encore le tiers au moins des membres de la CHS*.
Lors de la première réunion de l’année scolaire, la CHS* doit se doter d’un règlement intérieur élaboré par les membres de cette instance et approuvé par au moins la majorité d’entre elles et eux.
Par ailleurs, lors de cette première réunion de l’année scolaire, le·la chef·fe d’établissement doit présenter le rapport d’activité de l’année passée et le programme annuel de prévention des risques et d’amélioration des conditions d’hygiène et de sécurité.
Il est obligatoire pour la commission d’examiner, lors de ses réunions, les registres de l’établissement : le RSST* et le RGDI*. Elle doit aussi effectuer une visite des locaux de l’établissement au moins une fois par an.
Outre ces obligations précises, d’après les textes réglementaires, « La commission d’hygiène et sécurité peut être amenée à s’intéresser aux conditions de travail des élèves et des personnels ». Son champ d’action est donc large : la surcharge de travail et les burn-out, les agressions dont sont victimes les collègues enseignant·es ou non, la dégradation des conditions de travail, la précarité, les problèmes avec la hiérarchie, les emplois du temps, les locaux inadaptés ou dangereux… Elle peut, par exemple, être le lieu où le DUERP* est discuté.
Utilisons les CHS* !
Même si ces CHS* ne sont pas « vraiment » des F3SCT* et n’ont pas toutes les attributions de cette instance, pour SUD éducation, il est souhaitable et nécessaire de leur faire jouer un rôle similaire. La CHS* est un lieu d’informations, de débats, de contestation de l’organisation du travail, où les agent·es peuvent soulever toutes les problématiques de leur métier. Ce serait dommage de se priver de ce lieu d’expression et de proposition !
Les références réglementaires
- Décret 82 – 453 + guide juridique de la DGAFP
- Décret 2020 – 1427 (transcrit dans le Code général de la fonction publique) + guide juridique de la DGAFP
- Les CHS d’établissement sont instituées par le décret n° 91 – 1194, recodifié dans le code de l’éducation : article L421-25, articles D421-151 à 159).
Les revendications de SUD éducation
SUD éducation revendique :
- le retour aux CHSCT comme instances représentatives en charge des conditions de travail et de la santé au travail ;
- la création d’un CHSCT dans chaque école et établissement ;
- la création d’un délit d’entrave pour sanctionner les non-réponses de l’employeur ;
- l’intervention de l’inspection du travail dans l’Éducation nationale en toute indépendance.
5 - Les actions possibles quand la santé est affectée, ou quand la sécurité est menacée
La protection fonctionnelle est prévue par le statut général de la fonction publique (Article L134‑5 du Code de la fonction publique). C’est une garantie offerte aux agent·es : l’administration doit protéger un·e agent·e qui a été victime d’une attaque du fait de ses fonctions ou de sa qualité d’agent·e public·que. Elle s’applique également si l’agent·e, qui n’a pas été encore attaqué·e, estime qu’il y a un risque réel d’atteinte grave à son intégrité physique. Les atteintes donnant lieu à la protection de l’agent·e doivent affecter celui/celle-ci et être en rapport avec l’exercice des fonctions.
Il peut s’agir d’une agression physique ou verbale, de menaces, de la dégradation de biens ou d’un vol, ou bien d’un comportement assimilable au harcèlement moral ou sexuel. La protection fonctionnelle couvre également un·e agent·e qui est mis·e en cause dans le cadre de ses fonctions, c’est-à-dire quand on lui reproche d’avoir commis une infraction dans le cadre de son travail. Dans certains cas, la protection peut être accordée aux enfants et/ou conjoint·e de l’agent·e, toujours si les faits en cause sont liés à l’exercice des fonctions.
Bénéficiaires
Le terme d’agent·e public·que recouvre l’ensemble des fonctionnaires ou ancien·nes fonctionnaires, mais aussi les agent·es non titulaires de droit public (assistant·es d’éducation, AESH*, contractuel·les). De par la jurisprudence, cette notion tend à s’étendre à divers contrats de droit privé au titre de la participation à l’exécution d’une mission de service public, et même à des collaborateur·ices occasionnel·les du service public dans certains cas.
Mise en œuvre de la protection fonctionnelle
Les mesures que l’administration doit mettre en œuvre sont de multiples natures. Il peut notamment s’agir de :
- la mise en sécurité de l’agent·e : une fois informée des agissements répréhensibles, l’administration doit mettre en œuvre toute action appropriée pour faire cesser les violences auxquelles l’agent·e victime est exposé·e, même lorsqu’aucune procédure judiciaire n’est enclenchée (par exemple, mesure interne de suspension conservatoire du mis en cause en cas de VSS* en attendant une commission disciplinaire).
- l’obligation d’assistance juridique : il s’agit principalement d’apporter à l’agent·e victime une aide dans les procédures juridictionnelles engagées ; l’administration peut payer les frais de l’avocat·e désigné·e par l’agent·e victime.
- l’obligation de réparation : l’administration doit compenser le préjudice subi (libre à elle de se retourner contre l’auteur des dommages).
Comment obtenir la protection fonctionnelle ?
Pour demander la protection fonctionnelle, il faut adresser un courrier à sa hiérarchie pour solliciter la mise en œuvre de la protection statutaire (en utilisant par exemple le modèle de l’encadré ci-dessous). Ce courrier doit être adressé par voie hiérarchique :
- au recteur ou à la rectrice dans le second degré ;
- au ou à la DASEN* dans le premier degré ;
- au président ou à la présidente d’Université dans le supérieur.
Dans ce courrier, on peut expliquer en détail les faits qui conduisent à cette demande, en explicitant ce qui prouve le lien entre les fonctions occupées et le préjudice subi. On peut si nécessaire joindre divers documents (par exemple la copie d’un éventuel dépôt de plainte). On peut également détailler les modalités de mise en œuvre que l’on sollicite
Il n’existe pas de délai pour faire une demande de protection fonctionnelle, toutefois il est recommandé de la faire le plus rapidement possible. Il vaut mieux faut toujours contacter SUD éducation pour être conseillé·e et accompagné·e dans cette démarche.
La protection fonctionnelle doit toutefois désormais, en cas d’agression ou de menace, être accordée automatiquement par l’employeur dès qu’il a connaissance des faits, sans que l’agent·e victime ait une quelconque démarche à accomplir (Plan ministériel pour la tranquillité scolaire de décembre 2024). Cela n’empêche bien sûr pas de faire une demande écrite pour détailler les faits et expliquer quelles mesures de protection semblent nécessaires. Naturellement, l’administration ne remplit pas cette obligation qu’elle méconnait, néanmoins, c’est important de lui rappeler ses obligations réglementaires.
En cas de refus
Trop souvent, l’obtention puis l’application de la protection fonctionnelle est un parcours semé d’embûches. Il faut batailler pour faire appliquer chaque disposition et pour faire respecter les droits des collègues. Ainsi, une fois que la demande a été envoyée, il y a plusieurs possibilités :
- l’administration accorde la protection fonctionnelle avec les modalités demandées ;
- l’administration accorde la protection fonctionnelle mais avec des restrictions ;
- l’administration refuse le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
- l’administration ne répond pas dans un délai de deux mois, ce qui équivaut à un refus.
Dans les trois dernières situations, il faut se battre. On peut notamment exiger que l’administration motive son refus (c’est une obligation légale). On peut également protester lorsque l’administration refuse de dispenser la protection fonctionnelle au prétexte que l’agent·e n’a pas porté plainte ou lorsque la plainte a été classée sans suite, car c’est en contradiction avec les textes réglementaires : il n’est pas nécessaire d’entamer une procédure pénale pour demander la protection fonctionnelle. C’est notamment le cas pour les situations de violences sexistes et sexuelles : trop souvent, les collègues qui ont dénoncé les violences subies ne bénéficient pas, selon les situations et les académies, d’une protection et d’un accompagnement convenables. Pourtant l’employeur est responsable de la santé et de la sécurité des agent·es sur leur lieu de travail ! Lorsque la protection fonctionnelle est refusée par l’employeur, on peut faire un recours administratif, puis contentieux.
Modèle de demande
Mme /M. …
Lieu d’exercice
à
Monsieur le Recteur ou Madame la Rectrice /le DASEN ou la DASEN (suivi de l’adresse)
s/c de votre supérieur·e hiérarchique
A lieu, le date
Objet : Demande de protection fonctionnelle
Monsieur, Madame le Recteur/le DASEN
Je demande par la présente à bénéficier de la protection fonctionnelle en application des dispositions des articles L134‑1 à L134-12 du Code Général de la Fonction Publique.
En effet,
Indiquer les événements qui motivent la demande de protection :
• préciser les faits et leur chronologie,
• indiquer l’identité des auteurs du dommage et les préjudices invoqués,
(Joindre tout élément de preuve des faits : témoignages, certificats médicaux, correspondance, …).
Dans la mesure du possible préciser les modalités dont vous souhaitez bénéficier au titre de la protection (soutien, assistance juridique, pris en charge des frais et honoraires d’avocat, prise en charge des frais de procédure)
Vous trouverez ci-joints le rapport de service fait à mon ou ma supérieur·e hiérarchique ainsi que le dépôt de plainte que j’ai immédiatement déposé suite à ces faits.
Je vous prie de croire, Monsieur Le Recteur /Madame La Rectrice /le /la DASEN, en l’assurance de mes respectueuses salutations.
SIGNATURE
Liste des pièces jointes :
• Pièce jointe n°1 :
• Pièce jointe n°2 :
Les références réglementaires
- Article L134‑1 à L134-12 du Code de la fonction publique
- Article 11 de la Loi n° 83 – 634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
- Circulaire du 5 mai 2008 relative à la protection fonctionnelle des agents publics de l’État
- Note de service du 4 décembre 2024
Les revendications de SUD éducation
- Le respect de la loi : le droit à la protection fonctionnelle est consubstantiel au statut des agents publics : on ne choisit pas ses collègues ni son public. On a donc droit à être protégé d’eux et elles en cas de difficultés ;
- Le bénéfice systématique de la protection fonctionnelle pour les femmes victimes de violences sexistes ou sexuelles ou de violences conjugales ;
- Le bénéfice automatique de la protection fonctionnelle pour les agent·es victimes d’agissement grave, sans demande à effectuer.
Déclarer les accidents de service, de travail ou de trajet revêt d’importants enjeux et bénéficient à la fois à l’individu concerné·e et à l’intérêt collectif.
Pour l’individu, le premier et principal enjeu est financier : tous les frais médicaux sont pris directement en charge. De plus, le traitement est maintenu intégralement sans amputer les droits à congé (maladies, maternité, paternité…) ainsi que certaines indemnités . Cela implique qu’il n’y a pas de jour de carence si l’accident est reconnu imputable au service.
Pour l’intérêt collectif, plusieurs aspects entrent en jeu. En premier lieu, cela force notre employeur à reconnaître l’aspect pathogène des situations de travail (et à en faire le bilan annuellement). En second lieu, dans le cas d’un congé maladie ordinaire, c’est la caisse d’assurance maladie qui paie, alors que dans le cas de l’accident de service ou travail, c’est l’employeur ! Ne pas déclarer (et faire reconnaître) ses accidents de service, de travail ou de trajet, c’est faire peser le coût de l’accident dû au travail sur toute la société au lieu de l’employeur.
Si vous avez un accident en lien avec le travail, vous pouvez le déclarer comme accident de travail /de service. Cela concerne toutes les situations où un événement précis, survenu sur votre lieu de travail ou à l’occasion du travail, cause un dommage à votre santé. Ainsi, qu’il s’agisse par exemple d’une chute dans les escaliers ou d’une confrontation violente avec la hiérarchie, tout fait survenu à l’occasion du travail (y compris en déplacement dans le cadre du travail) qui entraîne une lésion physique (foulure, coupure…), interne (accident vasculaire cérébral, malaise…) ou psychique (crise de larmes, choc émotionnel…), même minime, peut être déclaré comme accident de travail ou de service.
Un accident entraîne une lésion, physique ou psychique, mais celle-ci n’est pas forcément invalidante au point d’empêcher d’aller travailler. Ainsi, il est important de déclarer un accident de service, de travail ou de trajet, même s’il n’entraîne aucun jour d’arrêt de travail.
Trop souvent les personnels ne déclarent pas leurs accidents de travail, par méconnaissance des procédures et de l’intérêt individuel et collectif, ou par peur de l’administration. Pire encore, quand iels connaissent l’existence de cette possibilité, la complexité des procédures de déclaration est un gros frein. C’est pourquoi il est préférable de contacter les équipes SUD éducation pour être accompagné·e.
Alors, accident de travail ou accident de service ?
L’accident de travail s’appelle « accident de service » dans la fonction publique : les deux appellations font référence aux mêmes situations, mais concrètement, selon votre statut ou votre contrat, la procédure n’est pas la même :
- si vous êtes agent·es titulaires : reportez-vous au point 4.2.1 : les accidents de service‧
- si vous êtes contractuel·les : reportez-vous au point 4.2.2 : les accidents de travail.
Cela concerne uniquement les titulaires.
Ce que dit la loi
L’article L.822 – 18 du Code général de la Fonction publique donne cette définition : « Est imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. »
C’est l’accident de service, qui s’appelle accident de travail pour les agent·es contractuel·les de la fonction publique et pour les personnels avec des contrats de droit privé.
Les délais de déclaration
La déclaration d’accident de service ou de trajet (voir point 4.2.3. pour les spécificités de l’accident de trajet) prévue à l’article 47 ‑2 est adressée à l’administration dans un délai de quinze jours à compter de la date de l’accident.
Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 47 – 2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale.
Exemple : Un·e agent·e tombe dans les escaliers sur son lieu de travail, iel se relève sans blessures apparentes (juste ressenties). Un an après, un médecin constate de sévères lésions qu’il peut dater de manière précise et mettre en lien avec l’accident préalable. L’accident ayant eu lieu moins de 2 ans avant le constat de la lésion par le médecin, l’agent·e a alors 15 jours pour déposer son dossier de déclaration d’accident de service et faire valoir ses droits.
Le formulaire de déclaration
L’imprimé de déclaration d’accident de service peut être fourni par le médecin. Il est aussi disponible en ligne sur le site fonction-publique.gouv.fr. Cependant, il est important de contacter le syndicat le plus rapidement possible. Les démarches sont techniques, les délais sont courts, et la déclaration d’un accident peut demander de fournir des documents précis.
Attention : le formulaire de déclaration d’accident de service n’est pas un formulaire d’arrêt de travail.
L’arrêt de travail : le Congé d’invalidité temporaire imputable au service (Citis*) et les suites après la déclaration
Avec l’accident déclaré, l’agent·e est placé·e théoriquement automatiquement en Congé d’Invalidité Temporaire Imputable au Service (Citis*). C’est l’article 47 – 2 du décret 86 – 442 qui définit les modalités d’octroi du Citis* :
« Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits.
La déclaration comporte :
1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ;
2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. »
Le Citis* doit être accordé dès la déclaration de l’accident, et pas uniquement en cas de reconnaissance de l’imputabilité de cet accident. C’est la mise en œuvre de la présomption d’imputabilité des accidents de service. Les règles de carence ne s’appliquent pas.
Si l’accident venait à ne pas être reconnu imputable au service, alors ce congé (Citis*) sera reclassé en Congé Maladie Ordinaire (CMO*) ou Longue Maladie (CLM*) si nécessaire. Cela donnera alors lieu à l’application des règles de carence, rétroactivement.
Dans le cas d’un arrêt de travail, le formulaire de congé maladie (ordinaire ou accident de travail) doit être transmis à l’employeur dans un délai de 48 h pour ne pas perdre son traitement à taux plein sur la durée concernée par l’arrêt.
Les références réglementaires
- Articles L.822 – 18 à L.822 – 25 du Code général de la fonction publique
- Article 47 – 2 du décret 86 – 447
Cela concerne les contractuel·les de la fonction publique.
Ce que dit la loi
L’accident du travail est défini par l’article L411‑1 du Code de la sécurité sociale : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
L’accident est présumé imputable au service.
La déclaration de l’accident du travail
L’accident du travail peut être déclaré dans un délai de 2 ans.
Selon l’article L. 441 – 2 du Code de la sécurité sociale, « L’employeur ou l’un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d’assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés. La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu’à l’expiration de la deuxième année qui suit l’accident. »
Donc, lorsque l’employeur est informé d’un accident de travail, il est dans l’obligation de le déclarer à la caisse d’assurance maladie. Dans les articles L.114 – 17‑1, L. 471 – 1 et R.471 – 3 du Code de la sécurité sociale, sont punis d’une amende les employeurs qui ont négligé de procéder à la déclaration des accidents à la Caisse primaire dans les 48 heures ou de délivrer à la victime la feuille d’accident.
Dans les faits, l’employeur n’effectue pas toujours ces démarches, par omission ou méconnaissance, ce qui peut entraîner des difficultés dans les reconnaissances de l’accident de travail. L’accompagnement syndical doit permettre de s’assurer que l’employeur respecte cette obligation. Prendre contact avec la CPAM pour savoir si l’accident a bien été déclaré par l’employeur peut également aider.
Attention : notre employeur peut aussi émettre des réserves sur le caractère professionnel de l’accident auprès de la caisse primaire d’assurance maladie, réserves qui doivent être motivées, et transmises durant un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle la déclaration a été effectuée (cf. art. R. 441 – 6 du même code).
Toutefois, il convient de souligner que c’est la caisse qui est chargée de reconnaître ou non le caractère professionnel de l’accident par décision motivée (cf. art. R. 441 – 18 du code de la sécurité sociale).
Si le caractère professionnel de l’accident est reconnu par décision de la CPAM, l’intéressé·e aura alors droit au versement des indemnités journalières de la CPAM et d’un complément de la part de son administration employeur afin de garantir une rémunération complète dans les limites suivantes : (cf. art. 14 du décret n°86 – 83)
- pendant un mois dès l’entrée en fonction ;
- pendant deux mois après deux an de service ;
- pendant trois mois après trois ans de service.
Au-delà de ces délais, l’agent·e perçoit seulement les indemnités journalières de la CPAM qui lui sont versées :
- soit par l’administration pour les agents recrutés ou employés à temps complet ou sur des contrats d’une durée supérieure à un an (c’est la subrogation)
- soit par la caisse primaire de sécurité sociale dans les autres cas.
Attention : Dans les cas où la subrogation n’est pas effective (contrat de moins d’un an ou à temps incomplet), il est possible que l’agent·e perçoive en même temps les indemnités journalières (IJ) de la CPAM et son salaire. Et quand l’employeur s’en aperçoit, il demande au salarié ou à la salariée de rembourser ; ou pire, il effectue des retenues sur salaire ! Il faut être très vigilant·es face à ces situations, qui peuvent mettre les agent·es dans de sérieuses difficultés financières. Il sera toujours possible si besoin de faire appel aux services sociaux du rectorat, ou de demander un échelonnement des prélèvements sur salaire.
Les références réglementaires
- Décret n° 86 – 83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, et notamment article 2 et article 14
- Code de la sécurité sociale : article L411‑1, article L. 441 – 2, article L.114 – 17‑1, article L. 471 – 1
L’accident de trajet est un cas particulier de l’accident de travail ou de l’accident de service. Cependant, même si les démarches sont similaires, il y a des spécificités à prendre en compte. Cela va dépendre du régime qui s’applique : celui de l’accident de service ou celui de l’accident de travail. Pour savoir de quel régime vous dépendez, il faut se référer à l’introduction de ce chapitre 4.2.
Les spécificités de l’accident de trajet]
ATTENTION : Pour l’accident de trajet, il n’y a pas de notion d’imputabilité, c’est à l’agent·e d’apporter la preuve.
L’accident de trajet ne concerne que les trajets lieu de résidence-travail, ou lieu de restauration-travail.
ATTENTION : Si l’accident sur le trajet survient entre notre lieu de travail et un autre lieu de travail (déplacement entre deux établissements pour les personnels itinérants, en service partagé, en PIAL, etc.) ce n’est pas un accident de trajet mais un accident de travail ou de service (voir plus haut), car cela ne concerne pas un trajet entre le lieu de résidence (ou de restauration) et le lieu de travail.
Pour les personnels relevant du régime de l’accident de service
Pour les personnels relevant du régime de l’accident de service, c’est l’article L822-19 du code de la fonction publique qui le définit :
« Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service. »
Comme dans le code du travail, pour l’accident de trajet, la charge de la preuve incombe donc à l’agent·e (ou ses ayants droits), il n’y a pas ici de présomption d’imputabilité au service.
Cependant, ce sont les mêmes modalités de déclaration que pour l’accident de service.
ATTENTION : Les délais de déclaration de l’accident de service s’appliquent aussi pour l’accident de trajet !
Pour les personnels relevant du régime de l’accident de travail
Pour les personnels relevant du régime de l’accident de travail (régime général – CPAM), l’accident de trajet est défini spécifiquement. L’article L411‑2 du Code de la Sécurité Sociale dispose que : « Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
- la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ;
- le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi. »
Les détours et arrêts de la vie courante
La résidence peut être la résidence principale, ou une résidence secondaire stable, ou tout autre lieu où l’on se rend de façon habituelle pour des motifs familiaux.
La notion de lieu habituel des repas n’impose pas une fréquentation strictement quotidienne et peut concerner d’autres parcours que celui menant au restaurant de service (administratif, école, établissement, universitaire).
Le trajet entre résidence et lieu de travail peut ne pas être obligatoirement le plus direct, si le détour est effectué dans le cadre d’un covoiturage régulier ou justifié par les nécessités essentielles de la vie courante. Les “nécessités essentielles de la vie courante” peuvent par exemple être : acheter du pain, passer prendre son/ses enfants à la crèche, à l’école, au périscolaire, etc.
Le CITIS est plus avantageux que le congé maladie ordinaire : lorsque l’imputabilité au service est reconnue, l’agent·e conserve l’intégralité du traitement indiciaire, l’indemnité de résidence et le supplément familial, ainsi que certaines primes et indemnités. Il n’y a aucun jour de carence, ni de baisse de rémunération à 90% du traitement. En revanche, certaines primes ou indemnités spécifiques ne sont pas versées, ce que SUD éducation dénonce car un accident lié au travail ne devrait jamais causer de préjudice à l’agent·e.
Une maladie peut être considérée comme professionnelle lorsqu’elle est contractée du fait du travail. Un tableau des maladies professionnelles recense les maladies reconnues comme telles. Lorsque le/la médecin traitant·e constate que la dégradation de l’état de santé de la personne malade est liée à son travail, que la maladie figure dans le tableau ou non, une procédure spécifique doit être enclenchée. Si l’origine professionnelle de la maladie est reconnue, la personne malade pourra alors percevoir des indemnités journalières plus élevées qu’en cas de maladie non professionnelle et une indemnisation spécifique liée à l’incapacité permanente. La déclaration de maladie professionnelle permet de bénéficier de la gratuité des soins liés à la maladie.
Comme pour l’accident de service, de travail ou de trajet, déclarer et faire reconnaître les maladies professionnelles est à la fois un enjeu individuel et un enjeu collectif. Là encore, du point de vue des avantages individuels, les frais médicaux sont pris en charge par l’employeur, et les arrêts de travail liés à la maladie ne consomment pas les droits à congés ordinaires.
Les enjeux collectifs sont également principalement ceux de la prévention des risques professionnels, et bien entendu de la charge financière : c’est l’employeur qui paie et non la société à travers la sécurité sociale. Ne pas déclarer et faire reconnaître les maladies professionnelles, c’est faire peser le coût de la maladie due au travail sur toute la société au lieu de l’employeur.
Comme pour l’accident de service ou de travail, les démarches varient en fonction de votre affiliation. C’est la même règle qui va s’appliquer :
- si vous êtes agent·es titulaires : vous dépendez du régime fonction publique
- si vous êtes contractuel·les : vous dépendez du régime général (la CPAM et le code de la santé publique)
ATTENTION : les démarches sont complexes et nécessitent un accompagnement syndical étroit. Rapprochez-vous de votre SUD éducation local pour être accompagné·e.
Pour le régime Fonction publique, c’est l’article L.822 – 20 du Code de la fonction publique qui définit la question :
« Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461 – 1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. […]
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice de ses fonctions.
Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461 – 1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. »
Pour le régime général, ce sont les articles L461‑1 à L461‑8 du Code de la santé publique qui s’appliquent.
La déclaration de maladie professionnelle est adressée à l’administration dans le délai de deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Exemple : un personnel est malade d’un cancer du poumon. Cela nécessite un traitement de 5 ans. Quatre ans plus tard, le médecin fait le lien avec une exposition à l’amiante sur son lieu de travail. Le personnel a alors deux ans à compter de cette date pour faire valoir ses droits.
L’imprimé de déclaration de maladie professionnelle peut être fourni par le ou la médecin. Il est aussi disponible en ligne sur le site fonction-publique.gouv.fr. Cependant, il est important de contacter le syndicat le plus rapidement possible. Les démarches sont techniques, les délais sont courts, et la déclaration peut nécessiter de fournir des documents précis.
Les références réglementaires
- Article L.822 – 20 du Code général de la fonction publique
- Article L.822 – 18 du Code de la fonction publique
- Article 47 – 2 du décret 86 – 447
- Article L461‑1 à 8 du Code de la Sécurité Sociale
Les revendications de SUD éducation
SUD éducation revendique :
- la reconnaissance immédiate de l’accident de travail (ou sur le trajet) dès lors qu’il se produit par le fait ou à l’occasion du travail,
- la reconnaissance des accidents de travail et maladies professionnelles liées aux risques psycho-sociaux
- la reconnaissance d’accidents du travail et de maladies professionnelles par une commission indépendante.
- l’information du médecin du travail de toute demande de reconnaissance d’accident de service.
- La création de tableaux de maladies professionnelles pour les pathologies liées aux RPS*
- la communication aux instances F3SCT départementales et académiques de toute déclaration d’accident grave, de service, du travail ou de trajet et de maladie professionnelle, pour rendre effectif le droit d’enquête de ces instances
Trop souvent, les personnels ne déclarent pas leurs accidents de travail ou maladies professionnelles, par méconnaissance des procédures et de l’intérêt individuel et collectif, ou par peur de l’administration. Pire encore, quand iels connaissent l’existence de cette possibilité, la complexité des procédures de déclaration est un gros frein, tout comme la mauvaise foi de l’administration. Elle est dans notre secteur juge et partie : c’est notre employeur qui est à la fois l’organisme de reconnaissance et l’organisme payeur. L’administration n’a donc aucun intérêt à reconnaître les accidents et maladies comme imputables au service.
La différence entre accident et maladie professionnelle est parfois ténue, et le choix de la procédure à suivre peut relever de la stratégie. C’est pourquoi il est fortement conseillé de se rapprocher de votre SUD éducation local, dès survenance de l’accident ou apparition de la maladie, pour être conseillé·e et accompagné·e au plus près de la situation.
La reconnaissance du handicap passe par l’attribution d’une Reconnaissance de la qualité de travailleur·euse handicapé (RQTH*). Est considérée comme travailleur·euse handicapé·e « toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ».
La RQTH* permet notamment de bénéficier d’un aménagement des horaires et du poste de travail. Elle permet ainsi à l’agent·e de bénéficier d’un temps partiel de droit (impliquant une rémunération amoindrie). C’est également un critère important dans la prise de décision de l’administration pour l’attribution de l’allègement de service (allègement d’au plus ⅓ du service, avec maintien de la rémunération complète). L’enveloppe des rectorats dévolues aux allègements de service étant insuffisante, ceux-ci sont fréquemment refusés aux personnels en ayant déjà bénéficié une année précédente, y compris pour les personnels ayant une RQTH*. SUD éducation dénonce cette situation qui met en concurrence les personnels en situation de handicap, un·e agent·e bénéficiant d’une RQTH* ne devrait jamais se voir refuser un allègement de service auquel iel a droit.
Les personnels ayant une RQTH* sont automatiquement bénéficiaires de l’obligation d’emploi (BOE*). Ielles peuvent à ce titre obtenir des modalités spécifiques de recrutement, et d’une priorité dans les mutations, via des bonifications de barème par exemple.
Cette RQTH* peut être délivrée pour de nombreuses pathologies dès lors que des altérations de l’état de santé réduisent la possibilité d’obtenir ou de conserver un emploi. La CDAPH* (commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées) vous reconnaît la qualité de travailleur·euse handicapé·e car votre handicap réduit votre capacité de travail.
Pour l’obtenir, vous devez présenter une demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées (www.mdph.fr) de votre lieu de résidence.
Attention : les démarches peuvent être très longues (souvent plus de 6 mois d’attente pour obtenir une réponse), n’attendez pas pour engager les démarches auprès de la MDPH*, même si vous pouvez bénéficier d’une procédure simplifiée.
Dans chaque académie, il y a un·e correspondant·e handicap, qui doit vous aider dans vos démarches. Le ou la médecin de prévention dispose de formulaires spécifiques qui permettent de bénéficier d’une procédure accélérée.
La MDPH* préconise un plan personnalisé de compensation (PPC*). La décision de la MDPH* précise la durée de la RQTH* (entre 1 et 10 ans, ou à vie si le handicap n’est pas susceptible d’évoluer favorablement), à son terme, vous devez renouveler votre demande.
Ne vous y prenez pas au dernier moment pour demander le renouvellement. Le décret n° 2018 – 850 du 5 octobre 2018 permet néanmoins de proroger la RQTH* jusqu’à la décision suivante afin d’éviter une rupture des droits.
Certaines personnes sont automatiquement bénéficiaires de l’obligation d’emploi et disposent des mêmes droits, sans faire de demande de RQTH* :
- les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % et titulaires d’une rente d’un régime de protection sociale obligatoire ;
- les titulaires d’une pension d’invalidité ;
- les titulaires d’une carte d’invalidité ;
- les titulaires de l’Allocation aux adultes handicapé·es (AAH*) ;
- les titulaires d’une Allocation temporaire d’invalidité (ATI*).
Les références réglementaires
- articles R5213‑1 à 5213 – 2‑2 du Code du travail
- article L. 146 – 9 du code de l’action sociale et des familles et détenteurs de la qualité de travailleur handicapé
- décret n° 2018 – 850 du 5 octobre 2018 relatif à la simplification de la procédure de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et à l’amélioration de l’information des bénéficiaires de l’obligation d’emploi
Les revendications de SUD éducation
SUD éducation revendique que :
- une attribution des allègements de service non en fonction de quotas académiques mais en fonction des besoins des agent·es ;
- la pérennisation du dispositif pour les personnels dont le handicap nécessite un allégement pérenne ;
- le raccourcissement des délais d’obtention de la RQTH ;
- la suppression du jour de carence pour tou·tes les agent·es, celui-ci pénalisant notamment les personnels en situation de handicap.
Si cette reconnaissance peut parfois améliorer des situations, cette procédure présente un danger de licenciement ou de mise à la retraite d’office pour inaptitude. Il conviendra donc de s’engager sur cette voie avec beaucoup de précautions et un accompagnement très personnalisé par un syndicat SUD éducation.
Deux reconnaissances de l’inaptitude existent :
- l’inaptitude à une fonction particulière, par exemple une inaptitude aux fonctions d’enseignement, ce qui ouvre droit au reclassement. Ce reclassement peut intervenir dans la fonction publique d’origine, la fonction publique d’état, ou à défaut dans une autre fonction publique, fonction publique d’état ou fonction publique territoriale. Cela peut être précédé par une période de pré-reclassement qui permet à l’agent·e de bénéficier d’une période d’essai et d’adaptation. Ensuite, l’agent·e peut être reclassé·e définitivement. Le reclassement est une obligation faite à l’employeur. Cependant, l’administration ne satisfait que trop rarement à son obligation de reclassement, notamment faute de places sur des postes administratifs pour les agent·es inaptes aux fonctions d’enseignement, de plus en plus nombreux·ses du fait de la dégradation continue des conditions de travail dans notre secteur.
- l’inaptitude à toute fonction, qui est synonyme de licenciement ou de mise à la retraite d’office : l‘agent·e reconnu inapte à toute fonction ne peut plus rester fonctionnaire puisque plus aucune fonction ne lui est attribuable.
La reconnaissance de l’inaptitude nécessite une expertise médicale qui peut être diligentée soit à la demande de l’employeur, soit à la demande de l’agent·e, et qui est réalisée par un·e médecin agréé·e.
Cette expertise médicale définit si l’inaptitude est totale ou limitée à une fonction. C’est un des éléments qui rendent la démarche périlleuse si l’on souhaite rester dans la fonction publique.
Cet avis du ou de la médecin agréé·e sera ensuite soumis à l’avis du conseil médical. Enfin, la décision finale de reconnaissance d’inaptitude revient à l’autorité administrative compétente (DASEN, Recteur·ice, Président·e d’Université).
Références réglementaires
- Articles L826‑1 à L826‑6 du Code général de la fonction publique
- Décret n°84 – 1051 du 30 novembre 1984
Revendications de SUD éducation
SUD éducation revendique que :
- les procédures de reclassement soient respectées
- tous les reclassements soient honorés, y compris avec les dispositions de transfert vers les autres versants de la fonction publique
6 - Conclusion : Défendre nos droits et en gagner de nouveaux, la nécessité des luttes collectives
À la lecture du guide, force est de constater qu’en matière de conditions de travail, le ministère ne respecte même pas la loi. Le premier combat syndical est donc de faire respecter nos droits, tout en créant le rapport de force pour en gagner de nouveaux.
Mais la tâche est grande, tant notre employeur s’évertue à individualiser les responsabilités plutôt que d’assumer son rôle. Si la souffrance au travail s’exprime d’abord à un niveau individuel, l’enjeu est la prise de conscience du caractère institutionnel, des causes de cette souffrance. Il importe donc de nous réapproprier des espaces collectifs pour mettre le travail et les conditions de travail en débat. Les Heures Mensuelles d’Information syndicale (HMI) et les Réunions d’Information Syndicale (RIS dans le 1er degré) permettent de le faire, de droit, sur le temps de travail. Nous devons prendre en charge de la manière la plus collective possible la question de nos conditions de travail. C’est ce qui permettra de créer le rapport de force à même d’obliger notre employeur à respecter nos droits.
En mettant constamment en débat les conditions de travail entre personnels et face à l’employeur, nous pouvons le contraindre à modifier l’organisation du travail. Les personnels doivent décider collectivement de leurs moyens d’action pour défendre leurs droits. Le principal et le plus efficace reste la grève. Les motions au conseil d’administration, ou au conseil d’école, les communiqués de presse… permettent de l’accompagner et de la construire.
De nombreux exemples partout en France nous prouvent chaque année que nous pouvons obtenir des améliorations de nos conditions de travail par la lutte collective. SUD éducation se veut être un outil au service de ces luttes. N’hésitez pas à nous contacter !
7 - Glossaire
Par ordre alphabétique :
- AAH : Allocation aux adultes handicapés
- ATI : Allocation temporaire d’invalidité
- BOE : Bénéficiaires de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés
- CA : Conseil d’administration, dans les établissements du second degré
- CHS : Commission d’hygiène et de sécurité
- CHSCT : Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
- CPAM : Caisse primaire d’assurance maladie
- CSA : Comité social d’administration
- CT : Collectivité territoriale
- DASEN : Directeur·ice académique des services de l’éducation nationale
- DGAFP : Direction générale de l’administration et de la fonction publique
- DSDEN : Direction des services départementaux de l’éducation nationale
- DTA : Dossier technique amiante
- EPI : Equipement de protection individuel
- EPC : Equipement de protection collectif
- EPLE : Etablissement public local d’enseignement (établissements du second degré)
- Éréa : Etablissement régional d’enseignement adapté
- F3SCT (ou FS-SSCT) : Formation spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail. Elle existe à l’échelle ministérielle, académique et départementale.
- HMI : Heure mensuelle d’information syndicale, aussi appelée HMI ou HIS
- IEN : Inspecteur·ice de l’éducation nationale
- IJ : Indemnités journalières
- INRS : Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles
- ISST : Inspecteur·ice santé et sécurité au travail
- Kaizen (management) : technique de management d’origine japonaise, décrite comme une “philosophie” ou une “mentalité” et nécessitant l’implication de tous·tes les employé·es, supposé·es proposer des améliorations pour une “amélioration continue” de la qualité du travail.
- Lean management : de l’anglais lean, “maigre” : méthode de management qui recherche la performance tout en éliminant les “gaspillages” comme les temps morts dans l’activité de travail par exemple.
- MDPH : Maison départementale des personnes handicapées, parfois nommée MDA (Maison départementale d’autonomie)
- MPCA : Matériaux et produits contenant de l’amiante
- QAI : Qualité de l’air Intérieur
- RAT : Repérage avant travaux, dans le cas de bâtiments contenant des MPCA*
- RGDI : Registre de danger grave et imminent
- RIS : Réunion d’information syndicale (1er degré)
- RPS : Risques psychosociaux
- RQTH : Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
- RSST : Registre de santé et sécurité au travail
- Segpa : Section d’enseignement général et professionnel adapté
- TMS : Troubles musculo-squelettiques
- VDHAS : dispositif de signalement des actes de Violence, discrimination, harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes au travail qui doit être mis à la disposition de chaque agent·e
- VSS : Violences sexistes et sexuelles
- VSST : Violences sexistes et sexuelles au travail